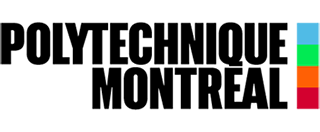Pour tout savoir sur les normes de sécurité en recherche, l'équipe du BEIR est là pour vous accompagner.
Qu'est-ce que la sécurité en recherche ?
La sécurité en recherche vise à protéger l’intégrité, la confidentialité et l'autonomie des activités scientifiques face aux menaces susceptibles de compromettre leur développement, leur exploitation et leur contribution aux intérêts sociétaux. Elle joue un rôle essentiel dans la préservation de la sécurité nationale en limitant les risques liés à l’ingérence étrangère, l’interférence, l’espionnage, le vol de propriété intellectuelle et les cybermenaces.
Dans un contexte de collaborations internationales et de concurrence mondiale, les équipes de recherche doivent être conscientes des risques potentiels.
- Des acteurs étrangers ou des entités malveillantes peuvent chercher à influencer, manipuler ou détourner les activités de recherche à des fins politiques, économiques ou stratégiques.
- Un transfert non désiré du savoir peut directement contribuer au renforcement des capacités étrangères en matière de défense, de renseignement et de surveillance, parfois au détriment de la sécurité nationale et des intérêts stratégiques du pays.
- Ces risques prennent diverses formes, allant du financement conditionnel et opaque à la coercition, en passant par la cyberintrusion et la manipulation de l’information.
La sécurité en recherche est une responsabilité partagée.
Chaque acteur du milieu de la recherche – chercheurs, l’établissement, organismes de financement et partenaires – a un rôle à jouer pour atténuer les risques. Adopter de bonnes pratiques de sécurité en recherche permet de limiter l’exposition aux risques et de mieux protéger les travaux scientifiques, la compétitivité et l’impact des innovations. Cela contribue également à renforcer la confiance des partenaires institutionnels et industriels.
Mettre en œuvre des mesures de sécurité en recherche favorise un environnement académique propice à l’innovation et à l’échange de connaissances, tout en réduisant les risques pouvant affecter l’intégrité de l’écosystème scientifique et la sécurité nationale. La sécurité en recherche repose sur une approche globale de gestion des risques, combinant la sensibilisation aux menaces, une évaluation rigoureuse des partenariats, la cybersécurité et la protection des données sensibles.
L’établissement dispose d’un plan institutionnel de sécurité en recherche, qui établit des objectifs et orientations pour encadrer la gestion des risques et outiller les équipes de recherche afin de favoriser l’adoption des meilleures pratiques.
La Politique sur la recherche en technologies sensibles et sur les affiliations préoccupantes (RTSAP) vise à protéger l’écosystème de recherche canadien contre les risques de transfert non désiré du savoir vers des entités étrangères jugées préoccupantes.
Cette politique s’applique aux demandes de subvention soumises aux trois organismes fédéraux (CRSH, CRSNG, IRSC) ainsi qu’à la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI). Un projet ne peut être financé s’il s'inscrit dans un domaine de recherche en technologies sensibles et si un membre de l’équipe de recherche associé aux activités financées est affilié à une des organisations de recherche nommées, ou s’il reçoit de celle-ci un soutien financier ou une contribution en nature.
En vertu de la politique RTSAP, tous les chercheurs ayant un rôle nominatif participant à des activités financées par la subvention doivent attester qu’ils ne sont pas affiliés à l’une des organisations de recherche nommées en complétant le formulaire d’attestation propre à chaque organisme subventionnaire.
Les Lignes directrices sur la sécurité nationale pour les partenariats de recherche (LDSNPR) visent à intégrer les considérations de sécurité nationale dans les processus d’élaboration, d’évaluation et de financement des partenariats de recherche.
Pour les programmes de subvention qui y sont assujettis, toute demande impliquant un ou plusieurs partenaires du secteur privé doit être accompagnée d’un formulaire d’évaluation des risques.
Pour remplir ce formulaire, les personnes candidates doivent faire preuve de diligence raisonnable. Cela signifie évaluer les risques associés à la nature des travaux et aux partenaires du secteur privé proposés, en s’appuyant notamment sur des sources ouvertes et des outils disponibles.
Un plan d’atténuation des risques doit ensuite être élaboré et appliqué pendant toute la durée de la subvention.
Conformément aux principes des LDSNPR, les mesures d’atténuation doivent être exemptes de tout profilage ou traitement discriminatoire envers un individu ou un groupe de la communauté de la recherche.
La Loi sur les licences d’importation et d’exportation (LLEI) encadre à la fois l’exportation, le transfert et le courtage de marchandises et de technologies, ainsi que l’importation de certaines marchandises au Canada. Elle s’appuie notamment sur deux instruments : la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC) et la Liste des marchandises d’importation contrôlée.
Si vos travaux de recherche impliquent l’exportation de biens, de technologies ou de données techniques à l’étranger, vous devez vérifier si ceux-ci sont régis par la LMTEC. Cela s’applique peu importe le mode de transmission : envoi physique, échange électronique ou communication verbale.
Les activités de recherche doivent respecter les exigences de la LLEI. Une exportation ou une importation non autorisée peut entraîner des conséquences graves, incluant des amendes et des peines d’emprisonnement.
Pays sanctionnés
Vous devez également vous assurer que vos activités respectent les régimes de sanctions économiques imposés par le Canada. Ces régimes peuvent interdire ou restreindre certaines exportations, importations ou activités, y compris l’aide technique (telle que la transmission d’informations, de données techniques ou technologiques, de savoir-faire, de formation, ou encore le soutien à l’utilisation d’une technologie), à destination de pays, d’organisations ou de personnes désignées, même lorsque les technologies concernées ne figurent pas sur la LMTEC.
Réception de matériel
De même, si vous recevez de l’équipement, du matériel ou de la technologie d’un partenaire étranger, il convient de vérifier si ces éléments sont assujettis à des contrôles à l’importation. Dans certains cas, une licence délivrée par le gouvernement canadien est nécessaire avant toute réception.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada.
Si vous avez des doutes quant à l’applicabilité de cette réglementation à vos travaux, ou si vous croyez qu’une licence pourrait être requise, veuillez communiquer avec notre équipe.
Qu’est-ce que le Programme des marchandises contrôlées?
Le Programme des marchandises contrôlées (PMC) est un programme fédéral canadien de sécurité industrielle. Ce programme met en application la Loi sur la production de défense (LPD) et son Règlement sur les marchandises contrôlées (RMC) afin de réglementer l’accès à certains biens technologiques sensibles. En pratique, le PMC oblige les personnes et organisations qui examinent, possèdent ou transfèrent des marchandises contrôlées à s’inscrire et à se conformer à des exigences strictes.
Attention. Ne pas s’y conformer constitue une infraction grave pouvant entraîner des poursuites et des sanctions sévères en vertu des lois fédérales. Les amendes peuvent aller jusqu’à 2 000 000$ et la peine d’emprisonnement peut aller jusqu’à 10 ans.
Objectifs du PMC
Les objectifs principaux du Programme des marchandises contrôlées sont :
- Protéger les biens stratégiques au Canada en empêchant leur accès par des personnes non autorisées. Le PMC vise à s’assurer que seules des personnes autorisées (ayant fait l’objet d’une évaluation de sécurité) puissent posséder, examiner et transférer les marchandises contrôlées.
- Prévenir la prolifération de technologies sensibles et renforcer le contrôle du commerce de défense, en soutien aux intérêts de sécurité nationaux et internationaux.
- Soutenir le régime canadien de contrôle des exportations. Le PMC complète les contrôles à l’exportation du Canada en surveillant sur le sol canadien la protection des marchandises militaires ou stratégiques, en appui à une base industrielle de défense nord-américaine intégrée.
Qu’est-ce qu’une marchandise contrôlée par le PMC?
Il s’agit de biens, de technologies ou de données technologiques à usage militaire ou stratégique, dont l’accès doit être restreint pour des raisons de sécurité nationale.
Le Règlement sur les marchandises contrôlées désigne comme marchandises contrôlées par le PMC certains articles répertoriés dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC), notamment :
- Groupe 2 – Liste de matériel de guerre (armes, munitions, véhicules blindés, etc.)
- Groupe 5, article 5504 – Marchandises et technologies stratégiques
- Groupe 6 – Liste du régime de contrôle de la technologie des missiles (systèmes de guidage, propulsion, etc.)
Ces marchandises peuvent prendre la forme d’équipements militaires, de composantes, d’électronique avancé, ou encore de données techniques comme des plans, des schémas, ou des logiciels liés à ces technologies. Le PMC encadre leur possession, leur examen et leur transfert sur le territoire canadien, qu’il s’agisse d’objets physiques ou de documents numériques.
Veuillez noter que certains cadres règlementaires américains peuvent s’appliquer au Canada.
Rôle des représentants désignés
Polytechnique Montréal est inscrite au programme des marchandises contrôlées (PMC). Ses représentants désignés sont:
- Joël Hobeila, poste 3396 – securite.recherche@polymtl.ca
- Lucie Jean, poste 2341
Les représentants désignés sont notamment responsables d’obtenir et de maintenir toute certification exigée par le PMC. Ils procèdent aux évaluations de sécurité pour tout employé, étudiant, cadre, administrateur susceptible de posséder, examiner ou transférer des marchandises contrôlées. En somme, ils sont les représentants de Polytechnique face au programme et permettent au personnel d’être admissible au PMC, tout en veillant à la conformité.
Procédure d'inscription
Dès que vous soupçonnez qu’un projet de recherche, une collaboration ou un achat pourrait concerner une marchandise contrôlée ou que vous avez un doute, contactez sans délai le représentant désigné de Polytechnique. Le représentant désigné vous aidera à déterminer si l’objet ou la technologie en question figure sur la liste des marchandises contrôlées et si le PMC s’applique.
Si l’activité relève du PMC, une demande d’inscription doit être initiée. Chaque demande doit être coordonnée par le représentant désigné qui effectuera l’évaluation de sécurité requise ou, dans certains cas, la transmettra au programme pour traitement. Si l’évaluation est approuvée, vous serez autorisé à accéder aux marchandises contrôlées.
N’hésitez pas à nous consulter à securite.recherche@polymtl.ca.