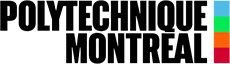Tout le monde fait partie de la diversité.

Les caractéristiques qui composent notre identité sont variées et peuvent être visibles (expression de genre, âge, couleur de peau, poids, etc.) ou invisibles (neurodivergence, orientation sexuelle, situation familiale, etc.).
En tant que membres de la communauté de Polytechnique Montréal, nous devons contribuer à faire de notre campus un milieu de vie, d’études et de travail bienveillant, sécuritaire et respectueux de la diversité qui enrichit notre collectivité.
Quels sont les concepts clés en matière d'ÉDI?
Il est important de noter que le lexique relatif à la diversité est en constante évolution. Certaines personnes peuvent ne pas se sentir à l'aise avec ces désignations ou préférer d'autres termes pour décrire leur identité.
L’accessibilité réfère à la possibilité pour toute personne de participer pleinement et de contribuer à la hauteur de ses capacités.
L’accessibilité universelle est une approche qui prend en compte les différents besoins et conditions de vie des personnes, notamment celles qui sont en situation de handicap, et vise une utilisation de l’environnement de vie, d’études et de travail sans obstacles (architecturaux, organisationnels, technologiques ou autres), permettant de bénéficier d’une expérience de qualité de manière autonome.
Présomptions ou généralisations de nature implicite, favorables ou défavorables, qui peuvent conduire à des jugements qui manquent d’impartialité ou à des comportements inappropriés, notamment à l’égard de certains groupes de personnes. Les biais inconscients peuvent se manifester, par exemple, sous forme de préjugés fondés sur l’apparence physique, l’âge, l’origine ethnique, le genre, l'orientation sexuelle, les capacités physiques ou cognitive et la religion, entre autres.
Ces préjugés sont façonnés par notre entourage, les valeurs de la société dans laquelle on vit ou l’environnement dans lequel on a grandi.
Il est toutefois possible de prendre conscience de ses propres biais par la réflexion active et l’adoption de comportements ouverts.
Les caractéristiques, visibles ou non, par lesquelles s’exprime la diversité peuvent provenir de nombreuses sources, notamment : le genre, l’âge, les origines ethniques, nationales ou géographiques, la langue, la culture, la religion, l’orientation sexuelle, la condition sociale ou le statut socioéconomique, l’éducation, la situation familiale ainsi que l’état ou les capacités physiques ou cognitives.
Terme utilisé pour présenter les différentes orientations sexuelles et les identités de genre, notamment des personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queers ou non binaires, intersexes, asexuelles, etc. (2ELGBTQIA+).
L'équité réfère à un traitement juste afin de garantir une réelle égalité des chances.
Ceci peut impliquer tenir compte des circonstances particulières des individus (p. ex. responsabilités familiales ou communautaires, statut socioéconomique, etc.) et éliminer des obstacles systémiques afin que tout le monde bénéficie des mêmes opportunités de participation, de développement et d’avancement.
Cadre ou environnement bienveillant et sécurisant, où chaque personne se sent en confiance, libre de s’exprimer et protégée contre toute forme de discrimination, de harcèlement, de représailles et de préjudice émotionnel ou physique.
À noter que les conditions dans lesquelles les gens se sentent en sécurité ne sont pas les mêmes pour tout le monde.
Certains groupes de personnes ont été historiquement sous-représentés dans les domaines des sciences et du génie par rapport à leur poids démographique, tout en faisant face à de ladiscrimination systémique en emploi.
C'est le cas notamment des femmes, des Autochtones, des personnes racisées, des personnes handicapées ainsi que des personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et de genre.
À l’inverse, les groupes-surreprésentés dans les milieux des STIM et les postes d'autorité incluent les hommes cisgenres d’ascendance européenne issus de milieux socioéconomiques privilégiés.
Le terme « personne handicapée » ou « personne en situation de handicap » inclut les personnes ayant des incapacités significatives et persistantes, sujettes à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. L’incapacité peut être motrice, visuelle, auditive, intellectuelle ou être liée à la parole, à d'autres sens, à des fonctions organiques ou à un trouble grave de santé mentale.
Le handicap englobe une variété de corps, de cerveaux, de conditions différentes, avec un large éventail de forces et de spécificités. Et bien que certains profils aient des dénominateurs communs, chaque situation est unique.
L’inclusion englobe les pratiques et comportements permettant de créer un milieu respectueux, ouvert, sain, sécuritaire et bienveillant, qui permet à chaque individu de conserver son caractère unique au sein du groupe, favorisant ainsi l’authenticité, l'appartenance et l’épanouissement.
L’inclusion exige un effort collectif afin que chaque personne se sente intégrée, soutenue et valorisée.
L'intersectionnalité est un cadre conceptuel, issu des travaux pionniers des féministes noires, pour examiner l’entrecroisement et l’expérience cumulative de multiples formes de discrimination ou de privilèges fondées, par exemple, sur la race, le sexe, le poids, l’âge, l’orientation sexuelle, la religion, la condition sociale ou les capacités physiques ou cognitives.
Cette liste n’est pas exhaustive tant les éléments de diversité peuvent être nombreux.
Propos, gestes ou comportements d’apparence banale mais qui, au fond, reproduisent des stéréotypes et contribuent à renforcer la marginalisation de certaines personnes ou communautés par leur caractère péjoratif, discriminant ou hostile.
Les microagressions sont généralement subtiles et peuvent paraître inoffensives aux yeux des gens qui les commettent, et donc être ignorées ou minimisées, mais leur effet cumulatif peut être blessant, insultant ou excluant pour les personnes qui les subissent au quotidien.
La « neurodivergence » ou « neurodiversité » fait référence à la variabilité naturelle dans le fonctionnement neurologique et cognitif humain. Les profils neurodivergents peuvent inclure des conditions telles que l'autisme, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H), la dyslexie, le syndrome Gilles de la Tourette et la douance.
Les barrières ou obstacles d’ordre systémique résultent de l’effet cumulatif d’exclusions attribuables à des structures, des pratiques et des cultures institutionnelles d’apparence neutre, mais qui peuvent directement ou indirectement créer ou perpétuer des iniquités ou des privilèges pour certains groupes de personnes.
Concept établissant que les femmes et les hommes doivent participer en égale mesure dans les espaces décisionnels et de création des savoirs, puisque l’humanité est composée de personnes de différents genres. Atteindre la parité signifie que le nombre de femmes et d’hommes est proportionnel au ratio dans la société, soit plus ou moins 50/50.
Lorsque le rapport femmes/hommes se situe entre 60% et 40%, il s’agit d’un ratio en zone paritaire.
Selon la théorie de « masse critique », un groupe qui est minoritaire dans une assemblée ne peut s’émanciper de la norme existante, ni agir différemment pour faire aboutir des initiatives spécifiques, qu’à partir d’un seuil équivalent à un tiers ou 30%.
La notion de « racisation » ou « racialisation » met l’accent sur le fait que la « race » n’est ni biologique ni objective, mais qu’il s’agit plutôt d’une idée construite par la société. La racisation d’un groupe peut se faire sur la base de la couleur de la peau, de l’origine ethnique, de la religion, de la langue, etc.
Au Canada, cette appellation désigne notamment les personnes Noires ou afro-descendants, les personnes asiatiques, les personnes arabes et latino-américaines non-blanches, les personnes d'origine mixte, etc.
Possibilité, pour chaque membre d’une communauté, de contribuer à la vie collective à la hauteur de ses capacités et aspirations personnelles.
État de santé global caractérisé par l’équilibre mental et le bien-être. Une santé mentale optimale permet à chaque personne de reconnaitre ses propres capacités, de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, d’entretenir des relations significatives et satisfaisantes, d’accomplir un travail fructueux et de contribuer à la vie de sa communauté.
La santé mentale, comme la santé physique, évolue sur un continuum dynamique, où chaque personne peut osciller entre différents états et niveaux de stabilité psychologique selon les circonstances de sa vie, son environnement et ses ressources personnelles. Cela signifie que l’on peut toujours retrouver un mieux-être, notamment si les problèmes sont détectés et traités tôt.
Les troubles de santé mentale sont des conditions affectant le bien-être psychologique et émotionnel, qui peuvent être temporaires ou chroniques (p. ex. troubles anxieux, dépression, troubles alimentaires, trouble obsessionnel-compulsif, bipolarité, dépendances, etc.).