Nouvelles
Première mondiale : un marqueur précoce de la maladie de Parkinson observé directement dans le cerveau humain grâce à l’implication d’une équipe de Polytechnique Montréal
Un regroupement de scientifiques mené par des équipes de l’Université de Cambridge, de l'University College de Londres (UCL), de l’Institut Francis Crick et de Polytechnique Montréal a mis au point une technique d’imagerie révolutionnaire. Grâce à elle, le collectif a réalisé une première mondiale : observer directement dans un cerveau humain le mécanisme moléculaire à l’origine de la maladie de Parkinson. Un exploit que certains membres du groupe comparent à « voir des étoiles en plein jour », et dont les résultats paraissent aujourd’hui dans la revue Nature Biomedical Engineering.
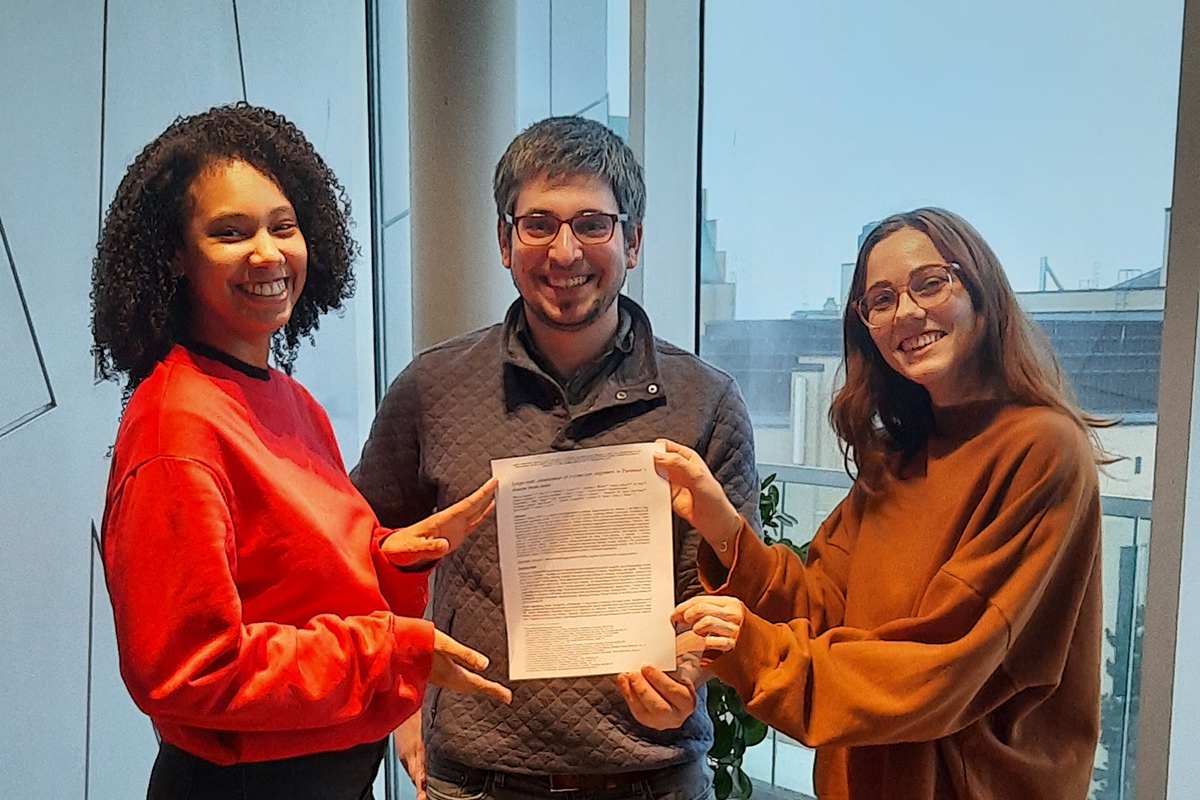
De gauche à droite : Kenza Baspin, diplômée au baccalauréat en génie physique (Po 2024); Lucien Weiss, professeur agrégé au Département de génie physique; Angèle Deconfin, diplômée au baccalauréat en génie biomédical (Po 2024).
La plupart d’entre nous avons vécu nos vies jusqu’ici sans avoir croisé le nom d’une protéine abondante dans notre cerveau : l’alpha-synucléine (α-synucléine). Pour les gens touchés de près ou de loin par la maladie de Parkinson, l’histoire est peut-être différente : cette protéine vient en tête de liste des suspects potentiels impliqués dans les débuts de la maladie.
Malgré des milliers d’articles publiés à son sujet, le rôle précis de l’alpha-synucléine dans les synapses de nos neurones reste encore à déterminer avec précision. Ce que les scientifiques savent très bien par contre, c’est qu’on retrouve de gros agrégats de cette protéine dans le cerveau des personnes décédées de la maladie de Parkinson. C’est même de cette façon que les médecins identifient depuis plus d’un siècle la maladie lors d’autopsies.
Or, ces gros agrégats, appelés « corps de Lewy », apparaîtraient tardivement selon les spécialistes. Ils constituent une conséquence de la maladie plutôt qu’un signe avant-coureur de son développement. Plusieurs soupçonnent que de plus petits agrégats d’alpha-synucléine sont tout de même en cause et endommagent les cellules plusieurs années avant l’apparition des premiers symptômes de Parkinson. Le hic, c’est que jusqu’ici, aucun outil ne permettait aux chercheurs de vérifier cette hypothèse. À l’échelle du nanomètre, distinguer les petits agrégats d’alpha-synucléine du bruit de fond des cellules provenant de signaux parasites et du signal des protéines saines d’alpha-synucléine s'avérait impossible. C’était un peu comme tenter de « voir des étoiles en plein jour », a d’ailleurs souligné aux médias britanniques Rebecca Andrews, co-première auteure de l’article et stagiaire postdoctorale à l’Université Cambridge lors de ces travaux. Les travaux du regroupement de chercheurs internationaux incluant l’équipe de Lucien Weiss, professeur agrégé au Département de génie physique à Polytechnique Montréal, viennent offrir une solution à ce problème. Leur approche permet de trouver une façon de discriminer les deux états de la petite protéine pour amener un nouvel éclairage sur la genèse de la maladie de Parkinson... comme si l'on pouvait distinguer la lumière des étoiles dans un ciel ensoleillé.

Des agrégats d’alpha-synucléine (en jaune) ont été observés à l’intérieur de microglies (cellules immunitaires du cerveau). L’existence de ces structures à un stade précoce de la maladie de Parkinson relevait de l'hypothèse jusqu'ici. Une hypothèse vérifiée par les travaux de l'équipe internationale de recherche. (Photo : Lucien Weiss)
Un coup de main de Montréal
Le groupe de recherche a mis au point une technique d’imagerie qui permet de visualiser, de compter et de comparer les agrégats dans des tissus cérébraux humains. Son nom : Advanced Sensing of Aggregates for Parkinson’s Disease (ASA-PD). Une approche dévoilée dans cet article publié dans la revue Nature Biomedical Engineering.
La nouvelle technique d’imagerie rend visibles les agrégats à l’échelle du nanomètre, soit un milliardième de mètre... ou 100 000 fois moins que le diamètre d’un cheveu. Elle s’appuie sur la microscopie par fluorescence ultra-sensible qui a permis de détecter et d'analyser des millions d’agrégats dans des tissus cérébraux autopsiés. Étant donné la petite taille de ceux-ci, leur signal était difficile à distinguer jusqu'ici. L’approche ASA-PD maximise maintenant leur signal tout en atténuant le bruit de fond des images, augmentant ainsi la sensibilité de détection des agrégats, au point de pouvoir observer et étudier des agrégats individuels d’alpha-synucléine.
La réussite s’est notamment appuyée sur l’expertise du professeur Lucien Weiss et de deux stagiaires au baccalauréat de Polytechnique Montréal, Kenza Baspin, diplômée en génie physique en 2024, et Angèle Deconfin, diplômée en génie biomédical la même année.
Le travail s'est amorcé en 2021, confie le professeur Weiss. « Suite à un postdoctorat, je suis venu à Cambridge en avril 2021 pour travailler sur ce projet, relate-t-il. J’ai cependant reçu en même temps l’offre de mon poste de rêve en tant que professeur à Polytechnique Montréal et j’ai donc pris la direction du Canada cet été-là. »
Grâce à cette collaboration, deux des premières recrues de Lucien Weiss ont eu la chance de contribuer au projet en étant notamment impliquées dans les réunions hebdomadaires du groupe avec leurs collègues européens. Angèle Deconfin a même eu l’opportunité de passer un été à Cambridge pour collecter des données sur place tandis que Kenza s’est concentrée sur l’amélioration des algorithmes utilisés pour améliorer la sensibilité de l’outil.
« Une nouvelle capacité d’analyse comme celle-ci nécessite beaucoup de validation, ajoute le professeur Weiss. Pour être certain que nous quantifions correctement les agrégats à l’échelle nanométrique, il a fallu mettre au point un nouvel ensemble d’outils algorithmiques, et Angèle et Kenza ont contribué à construire un ensemble fiable de données annotées qui a servi à concevoir et à ajuster l’algorithme en évaluant sa performance. Nous avons ensuite développé un ensemble d’outils de méta-analyse pour aider à trier l’énorme bibliothèque de données recueillies. »
L’outil a permis de comparer des échantillons de cerveaux prélevés lors d'autopsie chez des personnes atteintes de Parkinson et ainsi que chez des personnes saines du même âge. De petits agrégats ont été observés dans les deux populations d’individus, avec une différence tout de même marquante chez ceux qui avaient développé la maladie : on y voit des agrégats plus gros, plus lumineux et plus nombreux, suggérant un lien direct avec la progression de la maladie de Parkinson.
Les chercheurs ont également découvert une sous-classe d’agrégats qui apparaissait uniquement chez les patients atteints de Parkinson, ce qui pourrait constituer l’un des premiers marqueurs visibles de la maladie, et ce, potentiellement des années avant l’apparition des premiers symptômes.
Qui plus est, l'approche pourrait fournir des clés aux chercheurs qui s'intéressent à d'autres maladies neurodégénératives, souligne le professeur Weiss. « Cette méthode ne nous donne pas seulement une photo instantanée, dit-il. Elle offre une véritable carte de l’évolution des protéines à travers le cerveau, et des technologies similaires pourraient être appliquées à d’autres maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer ou la maladie d'Huntington. »
En savoir plus
Fiche d’expertise du professeur Lucien Weiss
Site du Département de génie physique
L'article Large-scale visualization of α-synuclein oligomers in Parkinson’s disease brain tissue publié dans l'édition du 2 octobre de Nature Biomedical Engineering




