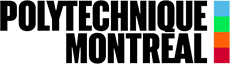Alors qu’il est désormais question de déconfinement et des moyens d’éviter la réapparition de la pandémie, l’enjeu des outils de traçage numérique et de leurs effets sur nos sociétés est certainement l’un des débats les plus urgents à entamer. Cette réflexion implique un nouvel arbitrage entre nos valeurs et nos choix futurs. Si les arguments avancés par les défenseurs des libertés individuelles et de la vie privée sont indéniablement pertinents et essentiels, la dimension de la protection des renseignements personnels n’épuise pas, à elle seule, les questions éthiques posées par la mise en œuvre de solutions techniques.
De façon concrète, si l’on admet que les applications de traçage ne sont efficaces que si elles sont utilisées par au moins 60 % de la population, il est impératif d’envisager un encadrement issu d’une gouvernance multipartite et transparente.
Sous l’égide de la Fondation de la technologie pour l’humain, un groupe d’experts multidisciplinaires du Canada, d’Europe et d’ailleurs (spécialistes des technologies, éthiciens et juristes) dont nous faisons partie, et qui comporte des chercheurs de l’OBVIA et des membres d’ITechLaw, se penche sur les conditions de mise en place d’une réelle gouvernance de toute solution technologique qui viendrait modifier la relation actuelle entre les citoyens et leur environnement. Pour le bien commun, cette gouvernance nous apparaît comme l’élément conditionnant le succès ou l’échec de tout dispositif.
Aussi, d’entrée de jeu, préconisons-nous la mise en place d’une instance diversifiée qui réunirait des députés et des membres du gouvernement, des experts, des représentants de la société civile et des corps intermédiaires, bref un regroupement à même de susciter la confiance et l’engagement des citoyens. Cette structure temporaire doit, d’une part, demeurer agile afin de s’adapter rapidement selon l’évolution de notre compréhension du virus et de ses modes de propagation et, d’autre part, garantir que les solutions exceptionnelles envisagées seront bien temporaires.
Gestion de risques
Nous proposons des processus et des outils de gouvernance responsable fondés sur des principes clés:
1. La plus grande transparence doit s’appliquer à toute réflexion impliquant un enjeu éthique ;
2.Il faut évaluer rigoureusement la réelle plus-value de toute solution proposée, d’abord en matière de santé publique, mais aussi sur le plan économique. Il ne s’agit pas de privilégier une seule solution, mais plutôt de comparer diverses approches technologiques afin de considérer l’apport de chacune d’elles, ainsi que l’efficacité de leur combinaison dans la lutte contre de nouvelles contaminations ;
3. La valeur d’autonomie et le respect des choix personnels sont à affirmer. Cette approche évite de mettre en contradiction l’intérêt individuel et l’intérêt collectif. Au contraire, elle les envisage comme renvoyant l’un à l’autre, en relation dynamique;
4. La valeur de justice sociale permettra d’éviter les risques d’ostracisation ou de discrimination selon les individus ou les secteurs géographiques. La vulnérabilité face à la maladie n’est pas la même pour tous et nous oblige à privilégier une technologie accessible à chacun;
5. L’évaluation de l’intérêt général doit être inclusive et réunir toutes les parties au sein d’un forum impliquant toutes les parties prenantes : corps médical, représentants de la société civile (en particulier des groupes vulnérables), des entreprises, du milieu éducatif, etc. Il ne peut être question d’abandonner aux seuls experts la décision du choix d’un système plutôt que de l’autre;
6. La proportionnalité des systèmes mis en place doit respecter la finalité d’origine. Ainsi, il conviendra, notamment, de minimiser la quantité des données collectées ainsi que la durée de leur utilisation.
Évidemment, toute technologie, quelle qu’elle soit, n’est qu’une pièce d’un dispositif plus large, incluant, notamment, les mesures sanitaires, le soutien apporté aux personnes potentiellement infectées, ainsi que l’encadrement des différents types d’activités économiques et sociales.
Une sortie de crise réussie, telle qu’elle est attendue par la population, nécessite de passer du mode « catastrophe sanitaire » à un processus de gestion de risques à moyen terme dans lequel doit être affirmé le rôle de coordinateur de l’État, tant dans la détermination des priorités de santé publique que dans la promotion de normes facilitant l’interopérabilité des technologies employées ici et ailleurs pour combattre la pandémie et pour promouvoir, autant que possible, la relance économique.
* Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction Chambre de la sécurité financière ; Anne-Marie Hubert, associée, directrice EY ; Nathalie de Marcellis-Warin, professeure titulaire, Polytechnique Montréal, coresponsable de la fonction « Veille et enquêtes » de l’OBVIA ; Charles S. Morgan, associé, McCarthy Tétrault, président, International Technology Law Association ; Jean-Louis Davet, président, Denos Health Management, Paris ; Éric Salobir, président, Fondation de la technologie pour l’humain, Paris.
Source: Le Devoir, 12 mai 2020