Nouvelles
Le MEI appuie quatre projets de Polytechnique Montréal en technologies médicales et en innovation sociale
Quatre projets issus des travaux de professeurs de Polytechnique Montréal iront de l’avant grâce à un appui du Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec (MEI). Des outils de diagnostics et d’aide à la décision en plus d’un biomatériau reçoivent un coup de pouce afin d’accélérer leur développement et leur application éventuelle pour répondre à des problématiques qui affectent les Québécoises et Québécois.
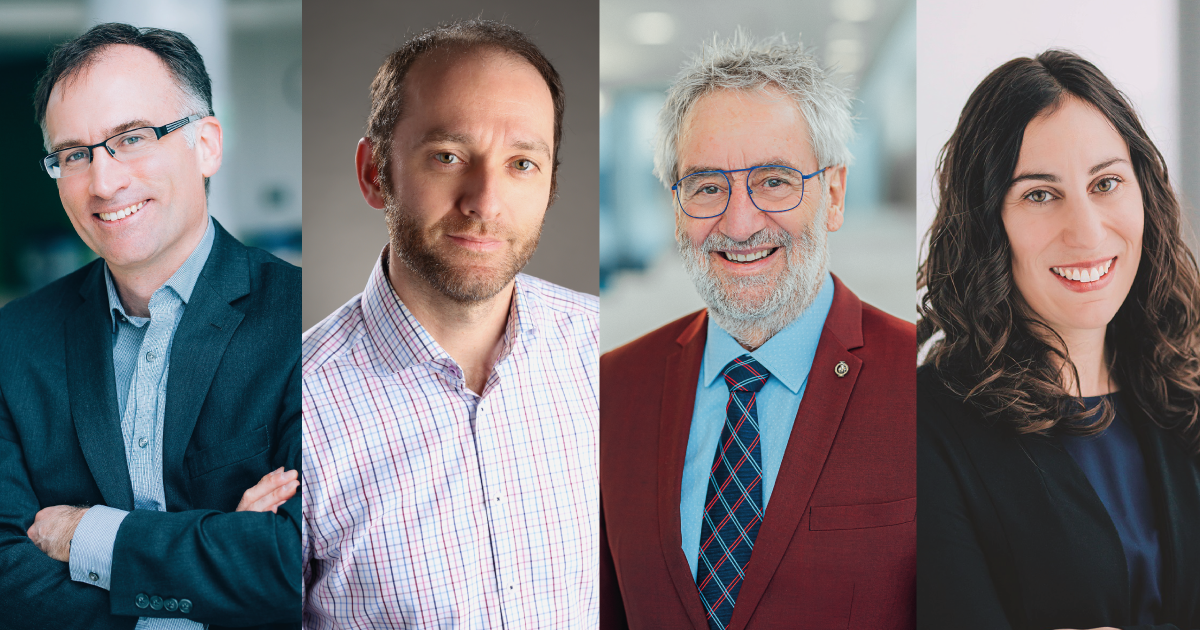
De gauche à droite : les professeurs Carl-Éric Aubin, Marc Lavertu, Réjean Plamondon et la professeure Françoise Bichai.
Ces projets ont fait l’objet d’une annonce officielle du MEI en marge du 89e Congrès de l’Acfas qui se tient cette semaine à Québec. En tout, 51 projets ont été appuyés. Ils se partageront une enveloppe globale de 17,4 millions de dollars.
Du lot, 9,5 millions seront consacrés à 21 technologies appuyées par Axelys, l’organisation à but non lucratif (OBNL) mise sur pied par le gouvernement du Québec en 2021, afin d’accélérer le développement et le transfert d'innovations à haut potentiel provenant de la recherche publique.
Axelys appuie cette année des projets en agriculture durable, en énergies propres et en technologies médicales. C’est dans cette dernière catégorie que se trouvent les trois projets de Polytechnique Montréal appuyés par l’OBNL. Des appuis qui s’additionnent à trois autres obtenus pour des technologies de l’Université de Montréal et qui confirment le positionnement du campus montréalais comme pôle de développement de dispositifs médicaux.
Un outil de simulation pour les chirurgies de la colonne vertébrale
Chaque année, environ 500 000 chirurgies sont réalisées en Amérique du Nord afin de corriger des déformations de la colonne vertébrale chez l’adulte. En insérant des tiges et en contraignant certaines vertèbres via des implants, les chirurgiens parviennent à redresser la colonne de leurs patients. Le hic, c’est que des complications postopératoires surviennent fréquemment, notamment des cyphoses jonctionnelles pathologiques au-dessus du segment instrumenté. Elles peuvent entraîner des bris de tiges ou des implants ou des fractures osseuses, allant jusqu’à des effets invalidants qui nécessitent une nouvelle intervention chirurgicale. On les attribue généralement à un débalancement spatial de la colonne causé ou à des choix chirurgicaux mal planifiés.
Dans le cadre des activités de la Chaire de recherche industrielle CRSNG/Medtronic en biomécanique de la colonne vertébrale, Carl-Éric Aubin, professeur titulaire au Département de génie mécanique, a développé avec son équipe une série d’outils de modélisation, de simulation biomécanique et d’optimisation afin de simuler les procédures chirurgicales de ce type d’intervention. Ils permettent aussi de réaliser des évaluations biomécaniques qui prédisent le résultat obtenu par chaque technique d’intervention ou de configuration de l’instrumentation de la colonne.
Avec l’appui d’Axelys et du partenariat industriel, l’équipe du professeur Aubin a pour objectif de poursuivre le développement d’un outil de planification chirurgicale. Cet outil est destiné à soutenir les bases biomécaniques que les chirurgiens pourraient prendre en compte dans la planification de leurs chirurgies.
Un biomatériau hybride pour réparer les ménisques
Bien difficile de réparer un tendon, un ligament, un ménisque ou un cartilage qui s’est déchiré. Dans son laboratoire de Polytechnique Montréal, l’équipe de Marc Lavertu, professeur adjoint au Département de génie chimique, a développé une stratégie susceptible d’accélérer la guérison de ces tissus mous, une technologie baptisée « Ortho-R ».
La technologie Ortho-R repose sur l’utilisation d’un biopolymère, le chitosane, un dérivé de la chitine qui compose notamment la carapace des crustacés. Une fois inséré au site d’une lésion, ce polymère agit comme matrice et permet aux cellules régénératrices du corps de réparer le tissu mou déchiré. Le chitosane ne s’acquitte pas seul de ce travail. On l’imprègne d’abord avec du plasma riche en plaquettes préparé à partir du sang du patient, une source de facteurs de croissance qui ont la capacité de stimuler la régénération des tissus. Le chitosane a pour avantage d’améliorer l’efficacité des plaquettes dans le processus de guérison en facilitant leur rétention au site de la lésion, tout en favorisant le recrutement cellulaire.
Grâce à l’appui d’Axelys, le groupe prévoit tester l’efficacité et l’innocuité d’Ortho-R dans un contexte de réparation du ménisque dans un modèle animal de grande taille, celui du mouton. Ces tests précliniques constituent la suite d’un programme de recherche que le professeur Lavertu et son partenaire industriel Ortho Regenerative Technologies mènent depuis plusieurs années. Le groupe débutera d’ailleurs en 2022 une étude clinique chez l’humain ciblant cette fois-ci la réparation des ruptures de tendons de la coiffe des rotateurs.
Un outil de mesure de la motricité fine chez l’enfant
Le développement de la motricité fine chez l’enfant suit le développement du cerveau et de son système moteur. Les praticiens ne disposent toutefois pas d’outils simples et conviviaux pour mesurer cette évolution de façon objective et s’assurer ainsi qu’elle se fait normalement.
Avec son équipe de Polytechnique Montréal, Réjean Plamondon, professeur titulaire au Département de génie électrique, a conçu et mis au point une approche susceptible de fournir des données objectives sur le développement moteur d’un enfant. Le groupe a développé ce qu’il appelle un « lognomètre », un outil informatique qui décortique les mouvements de la main en impulsions de vitesse qui s’affiche ensuite sur un graphique. En évaluant à l’aide de logiciels à quel point ces impulsions se distancient d’un résultat idéal dit « lognormal », l’outil offre une représentation numérique objective de l’état de la motricité fine d’un individu.
Tout se réalise grâce à un crayon et une tablette électronique qui enregistre la vitesse du crayon pendant le mouvement. Des exercices d’écriture variés vérifient différents aspects du mouvement de la main et de son contrôle par le cerveau. On demandera par exemple à l’enfant de relier des points le plus rapidement ou de faire un trait suite à un signal sonore ou visuel.
Avec l’appui d’Axelys et de ses partenaires, Ubisoft et Clinique MultiSenses, le professeur Plamondon envisage maintenant d’offrir une solution clé en main aux praticiens. On pourrait l’employer comme outil de référence lors de chaque examen médical pour apprécier le développement de la motricité fine d’un enfant, un peu comme on le fait avec la courbe de croissance. L’outil pourrait aussi aider le praticien à diagnostiquer et faire le suivi d’une commotion cérébrale ou d’un trouble de déficit d’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), notamment.
Un outil pour maximiser la résilience des villes
Françoise Bichai, professeure agrégée au Département des génies civil, géologique et des mines, a de son côté reçu un appui direct du MEI dans le cadre d’un appel de projets en innovation sociale, volet transition socioécologique. Son projet d’outil de planification stratégique des infrastructures vertes dans les villes a été retenu.
Les villes et municipalités préconisent de plus en plus l’intégration d’infrastructures vertes (comme les bassins de biorétention, les noues végétalisées, les marais artificiels, les toits verts, etc.) pour gérer une partie de leurs eaux pluviales et améliorer leur résilience face aux changements climatiques. Toutefois, leur implantation ne se fait pas de façon intégrée entre les différents services municipaux, ce qui empêche de maximiser tous les bénéfices socio-environnementaux que peuvent offrir de tels systèmes.
Dans le cadre de ce projet, l’équipe de la professeure Bichai prévoit développer et mettre à l’essai un outil d’analyse spatiale multicritère pour la planification stratégique des infrastructures vertes dans les villes québécoises. L’outil prendra en compte des aspects environnementaux, sociaux et urbains pour maximiser les bénéfices de chaque intervention tout en visant une distribution plus équitable de ces bénéfices. L’équipe développera notamment des critères liés à la gestion des eaux et des neiges urbaines, la biodiversité et la connectivité écologique, en plus d’intégrer plusieurs critères socio-environnementaux, liés, par exemple, à l’accès des citoyens aux espaces verts ou à la mitigation des ilots de chaleur.
Le projet est hautement multidisciplinaire et implique des chercheuses et chercheurs de l’INRS, de l’Université de Montréal et de l’Université du Québec en Outaouais. Il vise également à étudier le rôle potentiellement catalyseur d’un tel outil dans les processus de gouvernance et de prise de décision des municipalités, en soutenant l’intégration des parties prenantes à travers les silos du secteur municipal.
En savoir plus
Fiche expertise du Pr Carl-Éric Aubin
Fiche expertise du Pr Marc Lavertu
Fiche expertise du Pr Réjean Plamondon
Fiche expertise de la Pre Françoise Bichai
Accéder au communiqué officiel du Ministère de l'Économie et de l'innovation




