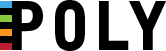
Le Magazine de Polytechnique Montréal
Quand la coopération est un hymne à l’honneur

(Photo : Avril Franco)
Les analogies et métaphores pour parler de la dimension sociale de la recherche foisonnent, allant de Newton assis sur les épaules des géants qui l’ont précédé aux proverbiales briques de l’édifice que forme la Connaissance. Un des éléments qui m’étonne le plus dans ma pratique en intégrité scientifique est cette pierre d’achoppement : la collaboration en milieu universitaire.
Tâchons d’esquisser une définition de la collaboration pour clarifier le concept. Au premier degré, la collaboration signifie travailler avec autrui. C’est un labeur partagé. Mais encore? Les questions d’intérêt en éthique sont : comment la collaboration prend-elle forme? Comment s’exerce-t-elle? Qu’est-ce qui la caractérise?
Le fameux aphorisme de Newton a été repris par Robert K. Merton1 afin de parler de l’éthos de la science. Celui-ci, sociologue des sciences du XXe siècle, a cherché à définir la culture prévalant en science. Dans ses textes et conférences, quatre valeurs peuvent être dégagées : communalisme, désintéressement, universalisme et scepticisme organisé. Pour faire simple, la science appartient à tout le monde (communalisme), n’est pas influencée par les intérêts personnels du chercheur (désintéressement) et peut être reconnue comme vraie par quiconque (universalisme). Merton les a définies à une époque où les régimes fascistes montaient en puissance et lorgnaient d’un œil intéressé – ou dégoûté, selon les domaines – ce qui se passait à l’université. Il s’en dégage une culture de collaboration et d’échange qui forme la trame de fond de l’essence universitaire. Les mouvements contemporains pour la science ouverte et les données ouvertes font écho à ces valeurs mertoniennes.
Toutefois, Merton nous donne peu d’orientation sur le « comment ».
Afin de mieux comprendre la collaboration, faisons un détour par la coopération telle que l’a définie Robert Axelrod, politologue américain qui s’est intéressé au célèbre dilemme du prisonnier2. Par concision, je vais m’attarder à ses conclusions plutôt qu'à sa démonstration et reconnaître d’emblée que si la collaboration implique une proximité et un travail mutuel, la coopération, elle, suppose une indépendance des actrices et acteurs rassemblés autour d’un but commun.
Grosso modo, dans un célèbre tournoi mettant à l’épreuve plusieurs stratégies de résolution du dilemme du prisonnier, celle qui s’est avérée la plus probante est celle dite « gentille, indulgente et qui riposte lorsque nécessaire. Elle n’est jamais la première à faire défection; elle pardonne l’occurrence d’une défection unique après y avoir dûment répondu; mais elle est toujours réactive à la trahison, peu importe à quel point l’interaction a été bonne jusqu’à présent » (trad. libre, 1984/2006 : 46). Être gentil, mais pas naïf. Fou de même. En somme, le fait de ne pas entretenir de vengeance et de faire confiance à l’autre est payant à long terme.
Si la confiance nous paraît centrale à l’intégrité, Axelrod considère que le fondement de la coopération se trouve davantage du côté de la durabilité de la relation entre les acteurs agissant dans la réciprocité. En fait, la réciprocité permet de faire collectivement front contre ceux qui égoïstement chercheraient à exploiter les autres.
Autrement dit, la coopération repose sur une approche de réciprocité du type « vivre et laisser-vivre » : « Causer de l’inconfort à l’autre n’est qu’une manière détournée de se l’infliger à soi-même », dira-t-il (trad. libre, Id. : 84).
Cette approche rappelle la règle d’or : « traite autrui comme tu veux qu’il te traite » ou, comme ma mère le dit si bien, « le respect attire le respect ». Ainsi, par retour de balancier, la coopération mène les personnes à se soucier du bien-être des autres parce qu’en retour, ces autres veilleront à leur bien-être. Cette réciprocité et ce souci de l’Autre ne sont pas étrangers à la notion de don et contre-don qui prévaut chez plusieurs Premières Nations, comme le souligne avec justesse la « Honour Song »3 chez les Mi’kmaq : « Ni’kma’jtut apoqnmatultinej » (« Mon peuple, aidons-nous les uns les autres »). Bref, la coopération, qu’elle prenne forme en milieu universitaire ou ailleurs, a une trame de fond universelle.
En définitive, Axelrod recommande de n’être ni envieux ni les premiers à trahir, de retourner toute action de coopération, mais de ne pas passer sous silence la trahison sans néanmoins chercher vengeance à long terme, mais surtout de ne pas tenter outre mesure d’être plus stratégiques que les autres.
Bref, la coopération implique une réciprocité, un échange dans la bienveillance, sans manigance, une capacité à pardonner les écarts de l’un au bénéfice du chemin à faire ensemble, à long terme. Nous lançons l’hypothèse que les mêmes enjeux touchent la collaboration, à la différence qu’une plus grande proximité unit les actrices et acteurs. Une belle leçon empirique à travers ces temps fous.
[1] Merton, R. K. (2017) Social Theory and Social Structure. South Asia Rawat publications.
[2] Axelrod, R. (1984/2006) The Evolution of Cooperation: Revised Edition. Basic Books
[3] Paul, G. (c.1980) Kepmite’tmnej (The Honour Song).


 disponible (Été 2024)
disponible (Été 2024)

