Blogue
Autopsie d'un pont


Avant de disparaître complètement du paysage montréalais, le Pont Champlain livrera quelques derniers secrets. (Crédit: PJCCI)
À l’ombre du nouveau pont Samuel-De Champlain, des ouvriers s’affairent depuis l’automne dernier à démanteler la structure de son vieux frère, le pont Champlain. Mais avant de disparaître complètement, l’ouvrage aura le temps de révéler quelques derniers secrets. C’est du moins ce qu’espère une équipe de Polytechnique Montréal qui est sur le coup. Au cours des prochains mois, elle accueillera dans son laboratoire une dizaine de dalles provenant du « vieux » pont pour jauger leur état de détérioration, mais aussi pour tester des façons de les « réparer ».

Nous sommes plusieurs à trépigner à l’idée que l’été arrive. Mais à Polytechnique Montréal, peu l’attendent avec autant d’enthousiasme que Jean-Philippe Charron et Mahdi Ben Ftima, professeurs au Département des génies civil, géologique et des mines et chercheurs au Centre de recherche sur les infrastructures en béton (CRIB).
C’est qu’avant de disparaître à tout jamais, le pont Champlain aura droit à une « deuxième vie ». Une partie des matériaux qui le composent seront réutilisés ou récupérés. Une autre donnera à des équipes de recherche l’opportunité de travailler avec des matériaux et éléments structuraux vieux de plus d’un demi-siècle. Le gestionnaire du pont, Les Ponts Champlain et Jacques-Cartier Inc (PJCCI) a initié en 2019 un programme de subventions visant à recueillir des propositions de recherche et de développement. Son objectif : profiter de la déconstruction du pont Champlain pour réaliser des projets de recherche portant sur plusieurs enjeux comme la dégradation, la durabilité et les méthodes novatrices d’évaluation et de renforcement de certains éléments du pont existant. Le projet proposé par les professeurs Charron et Ben Ftima a été retenu par PJCCI.
« C’est une chance exceptionnelle qui se présente à nous », souligne Pr Charron, visiblement enthousiaste. « On a rarement la possibilité de tester en laboratoire des éléments d’infrastructure qui ont autant de vécu. »
Ausculter le béton pour mieux le réparer

Depuis l’automne 2020, des ouvriers démontent section par section le tablier du pont Champlain. (Crédit : PJCCI)
Le « vieux » pont Champlain, c’est 17 000 tonnes d’acier et 12 000 tonnes d’asphalte.
La structure comprend aussi 253 000 tonnes de béton, soit l’équivalent en poids de 170 000 voitures.
Son gestionnaire, PJCCI, prévoit diriger une partie de l’acier vers des fonderies pour reformer de nouvelles pièces. Le béton, lui, sera concassé pour le transformer en matériau de remblai.
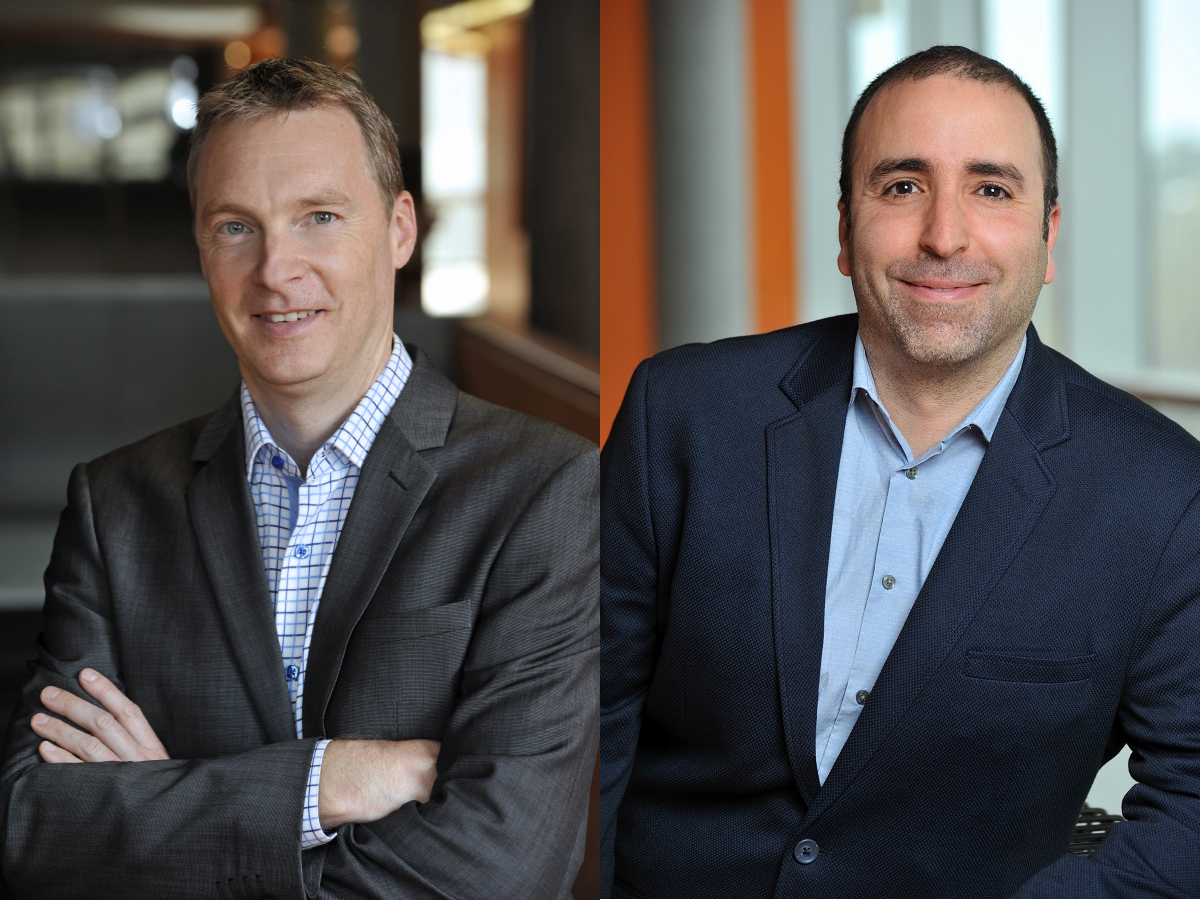
Pr Jean-Philippe Charron et Pr Mahdi Ben Ftima (Crédit : Denis Bernier)
Au laboratoire de structures, l'équipe des professeurs Charron et Ben Ftima caractérisera dans un premier temps chacune des dalles par des méthodes non invasives afin de mesurer leur état de détérioration et leur capacité portante résiduelle.
« Avec les années, les cycles de gel-dégel et la corrosion des armatures ont probablement réduit la performance du béton et des armatures, ce qui a probablement affecté la capacité des dalles à supporter les charges routières», explique le Pr Charron. « On souhaite déterminer à quel point elles ont été endommagées. »
Pour ce faire, son équipe auscultera certaines dalles en accolant des électrodes à sa surface, puis mesurera en plusieurs points la conductivité électrique du réseau d’armatures noyées dans le béton.
« En regroupant toutes les mesures, puis en réalisant des analyses numériques sophistiquées, on pense identifier précisément où sont les zones de corrosion dans le réseau d’armature», explique Pr Charron. « À partir de là, on estimera le diamètre résiduel des armatures et on évaluera la capacité portante résiduelle des dalles en flexion et en cisaillement. »
Ces données serviront également à améliorer les modèles numériques prédictifs développés par les chercheurs de Polytechnique Montréal et collègues du CRIB. À terme, ceux-ci permettront de simuler avec précision le comportement d’ouvrages de béton soumis à différentes conditions d’exposition.
Une validation de plus pour le BFUP
 La fabrication des bétons fibrés à ultra-hautes performances (BFUP) coûte plus chère que celle du béton armé, mais son utilisation pour réparer les infrastructures en béton permet de prolonger leur durée de vie de quelques dizaines d’années. (Crédit : Laboratoire des structures)
La fabrication des bétons fibrés à ultra-hautes performances (BFUP) coûte plus chère que celle du béton armé, mais son utilisation pour réparer les infrastructures en béton permet de prolonger leur durée de vie de quelques dizaines d’années. (Crédit : Laboratoire des structures)Voilà pour la partie diagnostic qui ne représente qu’une première étape. Cette information en poche, les chercheurs tenteront ensuite de « renforcer » certaines dalles au-delà de leur capacité initiale.
Pour ce faire, l’équipe du Laboratoire de structures entend miser sur un matériau qu’il étudie depuis plusieurs années : le béton fibré à ultra-hautes performances, ou BFUP.
À entendre Pr Charron, le BFUP, c’est un peu beaucoup le nec plus ultra de ce qui se fait dans le monde du béton. En plus d’être de 4 à 5 fois plus résistant en traction et en compression que le béton traditionnel, ce matériau se déforme en traction jusqu’à 0,2% sans former de fissure localisée. « On est dans un autre monde », lance-t-il.
La forte densité du BFUP le rend aussi 100 fois plus imperméable à l’eau et aux agents agressifs, comme les chlorures et les sulfates, qui sont susceptibles de l’endommager. En plus, si jamais une fissure localisée se forme et que l’eau s’y infiltre, les conséquences seront limitées pour la structure puisque ce béton cicatrise lui-même ses fissures. Il réussit ce tour de force grâce au ciment non hydraté qu’il emprisonne en très grande quantité et qui réagira au contact de l’eau pour sceller les fissures.
« Ça en fait non seulement un matériau idéal pour effectuer des réparations, mais aussi pour renforcer une structure sans ajouter une épaisseur supplémentaire de béton à la structure endommagée », indique le chercheur associé au Centre de recherche sur les infrastructures en béton (CRIB). « On peut anticiper qu’une réparation en BFUP prolongera de quelques dizaines d’années la durée de vie de nos infrastructures ».
À l’aide de réparations en BFUP, l’équipe de recherche tentera de renforcer la capacité structurale des dalles du pont Champlain en flexion et en cisaillement au-delà de leur capacité initiale lors de la construction. « Nous avons réalisé ces dernières années ce type de renforcement sur des dalles neuves en laboratoire. Les dalles vétustes du Pont Champlain nous offrent l’opportunité unique de démontrer la capacité de renforcement du BFUP sur des dalles endommagées. », lance Pr Charron.
Les BFUP ont été intégrés récemment dans les certains codes canadiens de construction en béton armé. Bien que leur intégration dans les structures gagne en popularité, elle demeure encore limitée. La validation des renforcements en BFUP prévue dans ce projet aura certainement un bon écho dans le domaine et conduira potentiellement plus de concepteurs à utiliser les BFUP.

Le Stade Jean-Blouin, à Paris, est l’une des premières œuvres architecturales à avoir été conçue en BFUP (Photo : dalbera, licence CC 2.0)
Des travaux retardés par la COVID-19
L’arrivée des premières dalles du pont Champlain à Polytechnique Montréal devait initialement se faire à l’automne 2020, mais la pandémie aura retardé le projet de désassemblage comme elle l’a fait pour tant d’autres. Les dalles sont attendues pour l’été et l’automne 2021.
D’ailleurs, Robert Tremblay, également professeur au Département des génies civil, géologique et des mines, aura lui aussi la chance de tester des matériaux en provenance du « vieux » pont, des sections d’acier dans son cas. Comme l’arche surplombant la voie maritime du Saint-Laurent ne sera pas démantelée avant l’hiver 2022, il faudra toutefois patienter au moins une année de plus dans son cas avant d’entamer des travaux de recherche directement sur des sections d’acier du pont Champlain.
Coup d'oeil sur... L'HISTOIRE DU BÉTON |
 
Avec sa coupole de béton non armé de 43 mètres de diamètre, le Panthéon de Rome témoigne des techniques avancées d’utilisation du béton que les Romains maîtrisaient déjà voilà plus de 2 000 ans. (Photo : pontfire, licence CC 2.5) L’histoire du ciment et du béton remonte aux débuts de l’Antiquité vers l’an 3000 avant J.-C. Un peu partout aux environs de la Mésopotamie, on développe différentes approches pour souder ensemble des matériaux à partir d’un liant capable de se solidifier. Les Égyptiens, par exemple, recouraient à un mélange de sable et de gypse auquel ils ajoutaient de petites pierres. Les Romains perfectionneront ensuite le procédé. Grâce à leur maîtrise de la fabrication du béton antique, ils érigent de grands édifices comme le Panthéon et tout un réseau d’aqueducs. Le matériau connait un nouvel essor au 19e siècle grâce à l’industrialisation de la fabrication du ciment ainsi qu’à plusieurs innovations. Les Français, par exemple, développent une approche où on laisse le béton se solidifier autour d’une armature en acier : le béton armé est né. Au 20e siècle, d’autres approches verront le jour, notamment celle du béton précontraint utilisé pour le « vieux » pont Champlain. On laisse alors le béton se solidifier autour de câbles d’acier tendus, augmentant ainsi davantage la capacité de l’ensemble béton-acier. Les bétons fibrés à ultra-hautes performances (BFUP) apparaîtront à la fin du siècle. Ils ont été utilisés jusqu’ici surtout en Europe et en Asie pour la conception de parements architecturaux, notamment le musée de Marseille, et de ponts. Au Québec l’usage du BFUP a débuté plus récemment, notamment avec la construction de la passerelle Isabey-Darnley composée d’une dalle en BFUP conçue par l’équipe du Pr Charron. |
En savoir plus
Fiche d'expertise de Pr Jean-Philippe Charron
Fiche d'expertise de Pr Mahdi Ben Ftima
Site Web du Groupe de recherche en Génie des Structures
Site Web du Département des génies civil, géologique et des mines (CGM)





Commentaires
Commenter
* champs obligatoire