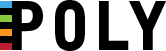
Le Magazine de Polytechnique Montréal
Une université d’influence
Mot de François Bertrand, directeur général adjoint et directeur de la formation et de la recherche

Photo : Denis Bernier
Dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation 2022 (SQRI), le gouvernement du Québec a entrepris un processus de consultation visant à déterminer les meilleures pratiques, les solutions novatrices et les avenues les plus porteuses pour favoriser la création de richesse au Québec à partir des activités de recherche et d’innovation. Polytechnique a répondu en déposant son mémoire, intitulé « La recherche en génie, source d’innovation responsable pour un Québec prospère » .
Je tiens aujourd’hui à vous exposer les concepts-clés de ce mémoire, qui permettent de mieux comprendre les bases de l’écosystème de recherche et d’innovation que Polytechnique est en train d’établir en droite ligne de son plan stratégique.
La formation : au cœur de nos activités de recherche
À Polytechnique, nous avons coutume de souligner que nous formons à la recherche et par la recherche. Pour encourager nos étudiantes et étudiants à poursuivre aux cycles supérieurs, nous avons mis en place plusieurs incitatifs. Par exemple, dès le baccalauréat, nous leur proposons une initiation à la recherche avec un programme, UPIR, dont l'objectif est de permettre à des étudiant(e)s au 1er cycle de se familiariser avec la recherche scientifique en travaillant sur un projet spécifique sous la direction d'une ou d'un chercheur. Nous recommandons au gouvernement que ce type d’initiatives soit généralisé et développé en collaboration avec les universités.
Nous avons également créé des accès accélérés vers la maîtrise ou le doctorat, ou encore des voies de formation enrichies, telles que celles proposées (profil industriel, entrepreneurial ou académique) aux étudiants aux cycles supérieurs et postdoctorants inscrits à l’Institut TransMedTech.
Selon notre expérience, les étudiants les mieux préparés à innover sont ceux qui savent naviguer à l’interface des disciplines tout en se spécialisant. Le financement d’initiatives de recherche pluridisciplinaire permettant l’intégration d’étudiants et d’étudiantes à tous les cycles doit donc être encouragé.
Enfin, personne ne nait ingénieur. Pour le devenir, il faut avoir été sensibilisé dans sa jeunesse aux sciences et initié à la démarche de création des technologies. C’est pourquoi Polytechnique prône la transmission d’une culture scientifique et technologique aux enfants et adolescents. Elle-même s’y emploie d’ailleurs avec succès à travers plusieurs initiatives, dont les programmes de Folie technique. Elle souhaite que les universités se mobilisent et reçoivent des ressources pour favoriser cette émulation auprès des élèves du Québec, en collaboration avec les autres parties prenantes du système éducatif.
Réaffirmer l’importance de la recherche
Polytechnique affirme que la collaboration des universités avec des acteurs socio-économiques doit s’effectuer en préservant la capacité des professeurs de réaliser une recherche libre, soutenue par des moyens financiers leur permettant de rémunérer leurs étudiants par des aides financières.
Polytechnique insiste également sur la nécessité d’une compréhension mutuelle des milieux socioéconomiques et universitaires de leur culture, contraintes et finalité respectives, tout particulièrement lorsque des activités de recherche présentent un potentiel de valorisation économique. À cet égard, elle espère que les futures zones d’innovation annoncées par le Gouvernement du Québec facilitent cet « apprivoisement » mutuel et que des incitatifs soient mis en œuvre pour encourager la collaboration les organisations les plus innovantes et les chercheurs universitaires. Soulignons que plusieurs entreprises ont externalisé la fonction recherche de leurs activités. Leur avantage concurrentiel dépend donc de plus en plus des programmes de recherche avec les universités.
La nouvelle société de valorisation, Axelys, dont je vous avais parlé dans mon billet précédent, reflète cette compréhension de l’interdépendance entre universités et entreprises montrée par le nouveau modèle de valorisation de la recherche publique du Québec.
Rôle clé des grandes infrastructures de recherche
Polytechnique dispose d’un parc d’infrastructures pour la recherche de pointe de l’ordre de 400 millions $. Comme c’est le cas dans les universités québécoises, ces équipements pourraient être plus exploités, en étant davantage accessibles aux entreprises à des fins d’innovation, en particulier les PME et jeunes pousses, et au meilleur coût possible.
Un soutien accru à leur exploitation serait nécessaire, en particulier dans les secteurs porteurs pour le Québec, car ni les universités, ni les PME, ne disposent des ressources pour défrayer les coûts d’une plus grande utilisation de ces infrastructures dont l’exploitation et l’entretien requièrent du personnel hautement spécialisé.
Création d’instituts de recherche de calibre international
Depuis cinq ans, Polytechnique a contribué à faire naître plusieurs instituts de formation et de recherche : IVADO (Institut de valorisation des données) et Institut TransMedTech. De nouveaux instituts liés à des enjeux pour la société (eau, cybersécurité, par exemple) sont aussi en voie d’être mis sur pied.
Ces instituts multidisciplinaires ont pour mission d’intégrer des activités de formation, de recherche, d’innovation, de commercialisation et de politiques publiques dans des secteurs précis. Le gouvernement peut jouer un rôle majeur en finançant ces initiatives structurantes qui participent au développement d’un écosystème de recherche et d’innovation ouvert à l’ensemble des acteurs dans leur secteur respectif, ici et ailleurs dans le monde.
Abaisser le niveau des risques technologiques
Peu d’acteurs économiques au Québec acceptent d’assumer les risques financiers pour amener la technologie sortant des laboratoires universitaires à maturité. D’où notre dépendance accrue envers les capitaux étrangers pour le développement de nos technologies clés, voire de secteurs entiers de l’économie.
Un soutien public à une combinaison d’initiatives, telles qu’adoptées par Polytechnique, est important car il permet d’abaisser le niveau de risque : incubateurs et accélérateurs, parcours entrepreneuriaux thématiques et en particulier l’approche living lab. Cette dernière, au cœur de l’Institut TransMedTech, implique la participation dès les premières étapes d’un projet de recherche de tous les acteurs impliqués dans le développement des technologies médicales, en particulier les patients et utilisateurs partenaires. Cette démarche augmente les probabilités d’appropriation des technologies par les utilisateurs finaux.
Nous pensons aussi que l’État a un rôle direct à jouer dans l’abaissement du niveau de risque aux yeux des investisseurs :
- en soutenant des projets de démonstration permettant de tester les technologies à différentes échelles et dans diverses conditions;
- en proposant des instruments financiers permettant de franchir les différentes « vallées de la mort » rencontrées sur le long parcours de l’innovation.
De plus, l’État dispose d’autres moyens pour influencer l’acceptation et l’adoption précoce des technologies :
- en contribuant à l’émergence de secteurs où des technologies « orphelines » pourraient un jour être valorisées et commercialisées;
- en devenant le premier utilisateur des technologies commercialisées par les entreprises dérivées de la recherche universitaire, afin de favoriser leur maturation.
Prendre davantage notre place dans l’arène internationale
Jusqu’à ce jour, la recherche menée en collaboration avec des partenaires à l’international n’a pas reçu de soutien significatif de la part des gouvernements.
Permettre à nos chercheurs du Québec d’être à la source d’innovations qui s'implanteront partout dans le monde demande une union de tous les paliers de gouvernement pour encourager et promouvoir la recherche à l’international. Ce qui implique de faciliter aux chercheurs d’ici – comme contributeurs mais aussi comme porteurs de projets – l’accès à des grands programmes internationaux, tels qu’Horizon Europe (un programme de l’Union européenne doté d’un budget de 95 milliards d’euros).
Dialogue science-société
Il est crucial que toutes les étapes de la recherche et du processus de valorisation de ses résultats reçoivent du secteur public un financement important et assuré sur le long terme. Pour que la population donne son assentiment à cet investissement public dans la recherche, elle doit pouvoir en comprendre les retombées positives pour sa propre qualité de vie et celle des générations futures. Nous pensons que les universités, les gouvernements et les organismes voués à la promotion des sciences partagent la responsabilité de valoriser aux yeux des citoyens l’activité scientifique.
Notre établissement participe au dialogue science-société et à la diffusion de la culture scientifique, notamment avec ses conférences grand public Les Rendez-vous de Polytechnique, son blogue Le Labo 2500 ou le lancement de son balado Histoires de génie. Nous émettons toutefois l’idée d’une campagne nationale visant à mettre en valeur la science et la recherche scientifique aux yeux du grand public.
Vous l’aurez compris, il est important que la future Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation prévoie un soutien gouvernemental renforcé envers les universités. Nous souhaitons aussi que l’ensemble de nos partenaires gouvernementaux et industriels, de même et que le public, prennent pleinement conscience que nos professeurs et nos futurs diplômés ne sont pas seulement des créateurs de technologies, mais des passeurs d’innovation vers la société.


 disponible (Automne 2021)
disponible (Automne 2021)
