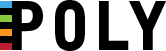
Le Magazine de Polytechnique Montréal
Prendre la bonne mesure des programmes de génie
Enseignement

Pierre G. Lafleur, président du Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG)
À la différence d’autres pays, le Canada n’impose pas d’examens techniques supplémentaires à ses diplômés en génie pour qu’ils soient admis dans la profession d’ingénieur. Ce sont les normes universitaires réglementées par le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG) qui assurent que la formation des diplômés répond aux exigences des organismes de réglementations. Nous avons demandé au président de cet organisme, M. Pierre G. Lafleur, d’expliquer de quelle façon sont établis les critères d’accréditation de formation des ingénieurs.
M. Lafleur, quelles évolutions ont marqué la façon dont le BCAPG évalue les programmes de génie depuis les deux dernières décennies ?
Je dirais que 2008 a marqué un tournant. Avant cette date, le BCAPG mesurait la qualité des programmes essentiellement en fonction de la place occupée par certaines disciplines, par exemple, les mathématiques ou la conception en ingénierie, dans leur contenu. À partir de 2008, le Bureau a ajouté une série de 12 compétences, que nous nommons qualités de l’ingénieur, attendues chez les diplômés. Ainsi l’équité, le professionnalisme, la déontologie et la capacité à travailler en équipe sont devenus notamment des critères très importants. De plus, les formations ont dû aussi inclure des aspects comme le développement durable ou la diversité, entre autres choses. Après une phase d’implantation, le BCAPG mesure l’acquisition des 12 qualités de l’ingénieur depuis 2015.
Aujourd’hui, je peux constater que l’apprentissage continu, la 12e qualité de notre liste, ne fait que croître en importance aux yeux des ordres professionnels. En raison de la transformation de la profession, notamment sous l’influence de l’intelligence artificielle ou du développement durable, l’ingénieur doit pouvoir combler ses besoins de formation tout au long de sa carrière. Comme il n’existe pas de cours spécifique sur l’apprentissage continu, les facultés de génie s’efforcent d’inculquer cette notion aux étudiants dans chaque cours.
Quels défis peuvent se poser pour les évaluations ?
Ce n’est pas toujours simple ! Avant, on pouvait évaluer un programme de façon ponctuelle. L’accréditation avait un cycle de six ans, au bout duquel l’université soumettait un rapport au BCAPG sur ses programmes en vue d’un renouvellement de l’accréditation. Depuis qu’on mesure des qualités, l’évaluation doit se faire en continu. Il revient aux universités d’assurer l’évaluation continue de l’acquisition des qualités requises chez leurs étudiants. On leur demande de corriger la situation si leurs mesures montrent que certaines compétences ont été insuffisamment acquises.
De plus, la volonté des ordres professionnels que les cours de conception en ingénierie soient toujours enseignés par des ingénieurs dûment accrédités représente parfois un enjeu, surtout dans des domaines fortement multidisciplinaires comme le génie biomédical, où des cours peuvent être donnés par des biologistes, des médecins ou d’autres professionnels.
Est-ce que la pandémie a eu des effets sur l’évaluation ?
Effectivement, entre autres, sur la façon dont se déroulent les visites d’agrément. Tout se fait de façon virtuelle en ce moment, même les visites des laboratoires d’enseignement.
Mais surtout, la pandémie a amplifié et accéléré le passage d’un grand nombre de formations au mode à distance. Le BCAPG est poussé à revoir la façon dont il évalue les contenus de programmes. Avant, on calculait le nombre d’heures où un étudiant était assis en face d’un professeur. Cela n’a plus grand sens aujourd’hui avec les cours en ligne, les cours hybrides ou les cours inversés. Une des avenues est de considérer plutôt le nombre d’heures où l’étudiant travaille pour obtenir les compétences visées par un cours.


 disponible (Printemps 2022)
disponible (Printemps 2022)

