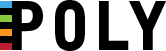
Le Magazine de Polytechnique Montréal
Pourquoi «faire de l'éthique» en milieu universitaire?

(Photo : Avril Franco)
« L’ignorance, c’est l’bonheur! », chante Plume Latraverse à la fin de Nous autres on s’en fout. Et ce n’est pas faux! Se moquer des encadrements, des critiques et « d’être pas sympathiques » peut apporter une certaine quiétude, mais être heureux dans sa vie n’est pas synonyme de faire une bonne vie. Autrement dit, ce n’est pas parce que ça va bien que c’est bien. Alors, comment savoir que l’on fait, dit et choisit la bonne chose?
Les codes de déontologie (devoirs et comportements attendus des membres d’un ordre ou d’une profession) sont utiles, mais contiennent certaines limites, notamment quand ils ne prévoient pas les situations nouvelles ou les pratiques émergentes. Je dirais que la déontologie, c’est le karaoké de la pensée : les paroles sont là pour accompagner une version approximative de la réalité… ce qui peut donner de fausses notes ou des dissonances. Par exemple, comment « l’ingénieur doit[-il] respecter ses obligations envers l’homme et tenir compte des conséquences de l’exécution de ses travaux sur l’environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne1 » dans le contexte, notamment, des secteurs sensibles comme l’intelligence artificielle, le militaire ou les infrastructures qui métamorphosent le territoire occupé par certaines communautés? Existe-t-il des contingences ou des pressions qui influencent son action? Cette exigence est-elle plus facile pour l’ingénieur chevronné, établi qui occupe un poste permanent que pour le candidat à la profession qui commence son premier emploi?
Heureusement, « c’est quand ça va mal que ça va l’mieux » (Plume, encore!), parce que nous pouvons alors innover par la réflexion… faire de l’éthique.
Nous pourrions résumer l’éthique à une réflexion sur les « choix touchant le sens de la vie […] et les orientations de l’action2 ». Les moteurs de nos actions/discours/choix sont les valeurs que nous portons en nous et considérons comme fondamentales. Par ailleurs, les normativités (p. ex. lois, règles, bonnes pratiques, codes de déontologie, normes, etc.) influencent l’étendue des possibles qui s’offrent à nous. Or, cette réflexion ne peut être faite en vase clos, car nous devons nous entendre avec les autres et, surtout, dans un contexte particulier (c.-à-d. l’ensemble des contingences, des contraintes et des conditionnements qui exercent une influence sur les personnes et qui permettent aussi de comprendre les vulnérabilités de chacun).
Faire de l’éthique serait donc ce processus de réflexion collective : entrer en dialogue avec les autres au sujet du sens de la vie (professionnelle, personnelle, universitaire, etc.) et des actions/discours/choix des acteurs. Ce dialogue vise non seulement à expliciter les valeurs – chez soi et chez l’autre –, les normativités, le contexte et les vulnérabilités, mais à tendre vers un consensus.
Faire de l’éthique, c’est prendre les instruments (c.-à-d. les connaissances, compétences, expériences) et jammer en gang au lieu de faire du karaoké.
Mais attention! Le consensus n’est pas forcément synonyme d’unanimité; il signifie que les personnes sont suffisamment d’accord pour avancer ensemble. L’éthique repose sur le pari démocratique voulant que la décision doive prendre acte des positions minoritaires ou dissidentes afin d’éviter une forme de tyrannie de la majorité.
Si les acteurs peuvent faire de l’éthique par eux-mêmes, il devient alors nécessaire de préciser à quoi sert l’éthicien… À quoi je sers? Selon Daniel Weinstock, « le rôle de l’éthicien n’est pas de fournir des réponses, mais d’éclairer des débats », afin d’identifier les valeurs en tension ou en conflit. Outre cet accompagnement, il doit non seulement transmettre ces connaissances, mais les développer par le biais d’une recherche continue. Il peut offrir des conseils aux professionnels dans le cadre d’un forum ou d’une publication, prendre part aux mécanismes de gouvernance et prendre la parole publiquement sur les problèmes éthiques portés à son attention. Bref, l’éthicien est une sorte d’homme-orchestre qui vient en renfort pour que le consensus soit vrai, que la chanson soit harmonieuse.
Donc, faire de l’éthique en milieu universitaire permet de réagir aux circonstances complexes qui nous plongent dans l’incertitude en raison de l’absence de repères reconnus. C’est un temps de réflexion qui vise à élever le débat au-delà de notre personne et prendre du recul sur la situation. C’est faire preuve de sagesse et ça, c’est l’bonheur!
1 Code de déontologie des ingénieurs, article 2.01.
2 BOURGEAULT, G. Éthiques : Dit et Non-dit, Contredit, Interdit, Presses de l’Université du Québec, 2004, p. 41.


 disponible (Été 2023)
disponible (Été 2023)

