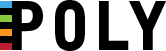
Le Magazine de Polytechnique Montréal
Polytechnique Montréal : le grand destin d’un projet visionnaire
Bâtir

Atelier des arts industriels en 1913 (Bureau des archives, Polytechnique Montréal)
À Montréal, au XIXe siècle, naît un établissement qui jouera un rôle crucial dans le développement économique du Canada et, plus particulièrement du Québec.
L’École Polytechnique de Montréal voit en effet le jour en novembre 1873. Elle formera des cohortes d’ingénieurs francophones qui contribueront à l’essor économique du pays. Aujourd’hui, alors qu’elle célèbre ses 150 ans, la voici à l’avant-garde des grands projets cadres internationaux de recherche. Voyons le long chemin qu’elle a parcouru.
Accompagner le Québec en mouvement

Un laboratoire au début du 20e siècle (Bureau des archives, Polytechnique Montréal)
À partir des années 1850, l’avènement des chemins de fer et le début de l’industrialisation suscitent de nouveaux besoins dans un Québec qui bouge. Politiciens, hommes d’affaires, journalistes et éducateurs évoquent alors la nécessité d’adapter son système d’éducation aux nouvelles réalités économiques. Selon eux, il devient urgent de former dans les établissements d’enseignement supérieur non seulement des médecins, des avocats ou des prêtres, mais aussi des géologues, des chimistes et, surtout, des ingénieurs.
En 1867, la Confédération, qui octroie la compétence exclusive de l’éducation aux provinces, va permettre de créer les deux premiers établissements voués à la formation des ingénieurs. En 1871, l’Université McGill inaugure le Department of Practical and Applied Sciences, embryon de ce qui allait devenir sa faculté de génie. Deux ans plus tard, les efforts du premier ministre Gédéon Ouimet et du principal de l’Académie commerciale catholique de Montréal, Urgel-Eugène Archambault, mènent à la fondation de l’École des sciences appliquées aux arts et à l’industrie, au sein de l’Académie, qui sera chargée de dispenser un enseignement scientifique et industriel en français. L’établissement sera officiellement rebaptisé École Polytechnique de Montréal par le gouvernement du Québec, en 1876. Archambault en devient le principal et le demeurera jusqu’à sa mort en 1904.
Des débuts difficiles qui laissent entrevoir de meilleurs jours
Les débuts de Polytechnique s’avèrent difficiles. L’absence d’une grande bourgeoisie canadienne-française et son isolement dans un système d’enseignement dominé par le clergé entravent son épanouissement. Les diplômés sont peu nombreux, soit pas plus de quatre par année entre 1877 (année de la première promotion) et 1904. Ces derniers œuvrent surtout dans l’administration publique fédérale ou gagnent leur vie à titre d’ingénieur-conseil. Il faut attendre le début du XXe siècle pour que les premiers signes annonciateurs de jours meilleurs se manifestent. Née dans le giron de la Commission des écoles catholiques de Montréal, un organisme, faut-il le rappeler, voué à l’enseignement primaire, Polytechnique passe officiellement sous la compétence de l’Université Laval, en 1887, et est affiliée à sa succursale de Montréal. En 1895, le gouvernement du Québec crée la Corporation de l’École Polytechnique de Montréal. Grâce à cette nouvelle instance, l’école de génie, qui reste affiliée à l’Université Laval, devient dès lors le principal artisan de son développement. Comme les bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules, Archambault a l’heureuse surprise d’apprendre, en 1901, que son école obtient 25 000 $ grâce à un legs de l’industriel Joseph-Octave Villeneuve. Elle pourra ainsi lancer la construction d’un immeuble digne de ce nom, inauguré en 1905, moins d’un an après la disparition de son fondateur. Elle quitte donc l’ancienne maison cossue d’un médecin, qui lui avait servi de demeure depuis sa fondation, pour s’installer rue Saint-Denis, tout près de la rue Sainte-Catherine (l’immeuble abrite aujourd’hui la haute administration de l’UQAM). Une nouvelle ère débute alors pour Polytechnique.
D’abord, l’École voit ses subventions accordées par le gouvernement atteindre des sommets. Ces dernières passent de 13 000 $ en 1905 à 56 000 $ en 1920, puis à 125 000 $ en 1930. Par ailleurs, en 1907, Polytechnique inaugure une section d’architecture. Elle formera ainsi, de 1907 à 1922, une première génération de diplômés francophones en architecture. Cette section, avec ses professeurs et ses étudiants, est transportée, en 1923, à l’École des Beaux-arts de Montréal qui voit alors le jour, tirant ainsi un trait sur la formation des architectes à Polytechnique.
Ce sont surtout les dirigeants et diplômés de Polytechnique qui vont mener un combat de tous les instants pour valoriser le statut de l’École et celui des ingénieurs. Ceux-ci ont, en effet, joué un rôle prépondérant dans la construction de l’identité sociale de l’ingénieur. Dès la création de la Société canadienne de génie civil (SCGC) en 1887, de rares diplômés de Polytechnique en font partie. À mesure que ces derniers croissent en nombre, ils rejoignent les rangs de ce lieu de regroupement des ingénieurs canadiens. La création, en 1908, de la section de Québec de la SCGC et les efforts de l’Association des anciens élèves de Polytechnique vont permettre la reconnaissance professionnelle des ingénieurs au Québec. En 1918, le Québec devient ainsi la première province canadienne à se doter d’une loi protégeant le titre d’ingénieur et la pratique de la profession. Deux ans plus tard, la Corporation des ingénieurs professionnels du Québec (ancêtre de l’Ordre des ingénieurs du Québec) voit le jour. Les diplômés de Polytechnique en occuperont les principaux postes de direction. À la même époque, la succursale de l’Université Laval à Montréal obtient sa complète autonomie et prend le nom d’Université de Montréal à laquelle Polytechnique sera désormais affiliée.
La conquête des administrations publiques québécoises
Bien qu’absents des grandes industries, les ingénieurs de Polytechnique ne chôment pas. Ils réussissent à décrocher des postes dans les administrations publiques qui leur permettent de jouer un rôle non négligeable dans la modernisation du Québec. Après avoir occupé des postes de direction au sein de la fonction publique fédérale, ils entrent massivement dans les instances publiques québécoises. Les ministères de la Voirie, des Travaux publics, des Mines, la Commission des eaux courantes sont des lieux d’exercice importants pour les diplômés. Il en va de même pour les services municipaux des grands centres urbains souvent dirigés par les ingénieurs issus de Polytechnique. La conquête des postes de commande dans ces lieux avantage certains diplômés qui se sont faits entrepreneurs en construction ou qui se sont lancés dans la pratique du génie-conseil. La réalisation de grands travaux municipaux (usines de filtration, systèmes d’aqueduc, tunnels routiers, édifices publics, etc.) ou de travaux publics commandés par le gouvernement provincial (par exemple barrages hydro-électriques, grandes routes, écoles) permet à des bureaux francophones d’ingénieurs-conseils de s’imposer dans ce secteur de l’économie. Les Marius Dufresne, Arthur Surveyer, Séraphin Ouimet, Stanislas-Albert Beaulne, etc., tous des diplômés de Polytechnique promus entre 1900 et 1915, ont fondé des entreprises dont la réussite ne passe pas inaperçue. L’un des diplômés, issu de cette période précédant la Grande Guerre, va jouer d’ailleurs un rôle crucial dans le développement de Polytechnique et, plus largement, dans l’histoire de la radiodiffusion au Canada.
Augustin Frigon obtient son diplôme d’ingénieur de Polytechnique en 1909. Il part aussitôt suivre des cours en génie électrique au Massachusetts Institute of Technology (MIT). Il revient l’année suivante à Montréal et est aussitôt engagé comme professeur par son alma mater. Attaché au Laboratoire d’électricité, il est pressenti pour succéder au vieux médecin, Salluste Duval, qui en est le directeur. Mais avant, Frigon désire aller se perfectionner en France et fait une première demande en ce sens en 1914. Le déclenchement de la guerre vient cependant miner son projet. Il partira finalement pour l’Europe en 1920. Il est de retour à Montréal en 1922 avec, en poche, un diplôme d’ingénieur électricien de l’École supérieure d’électricité de Paris et un doctorat ès sciences de la Sorbonne. En 1923, il devient le troisième directeur de Polytechnique et, surtout, le premier Canadien français à occuper cette fonction. Son passage comme directeur, de 1923 à 1935, l’amène à moderniser tout le programme d’études de Polytechnique. Il cumule également une multitude de postes dans des organismes publics qui lui permettront de marquer l’histoire du Québec. En 1936, il devient principal de Polytechnique et directeur général adjoint de la nouvelle société d’État, Radio-Canada. À ce titre, il met sur pied le premier réseau francophone de cette société. C’est d’ailleurs lui qui impose l’appellation Radio-Canada pour la section francophone du réseau canadien. Le réseau anglais tient, en effet, à garder l’appellation d’origine, Canadian Broadcasting Corporation (CBC). En 1943, Frigon devient le directeur général de CBC/Radio-Canada et met ensuite sur pied Radio-Canada International. Il s’éteint en 1952 au moment où la société d’État diffuse ses premières émissions télévisuelles.
Polytechnique au cœur de la révolution tranquille

Traitement des minerais en génie minier, 1965 (Bureau des archives, Polytechnique Montréal)
Au début des années 1950, les ingénieurs francophones, pour la plupart formés à Polytechnique, éprouvent toujours des difficultés à franchir les portes de la grande industrie. Rappelons qu’en 1953, 108 des 119 ingénieurs du complexe Alcan à Arvida sont des anglophones. Or, le vent s’apprête à tourner pour les futurs diplômés polytechniciens. D’ailleurs, Polytechnique quitte, en 1958, le Quartier latin pour emménager dans un tout nouvel immeuble sur les flancs du mont Royal, à un jet de pierre du campus de l’Université de Montréal. L’année suivante confirme que les temps changent. Gabrielle Bodis devient la première femme diplômée de Polytechnique. En 1961, on compte 10 femmes sur les 1 400 étudiants. Dix ans plus tard, elles sont une soixantaine, soit environ 3 % de l’ensemble des étudiants. Par ailleurs, le directeur du Laboratoire de résistance des matériaux de Polytechnique, le professeur Georges Welter, recruté en 1941 à la faveur de l’exode de nombreux chercheurs européens fuyant la guerre, met en place la recherche et forme les premiers doctorants. Polytechnique devient dès lors un établissement d’enseignement de haut niveau et un lieu où la recherche est une composante reconnue. En 1970, le Service de la recherche est créé, signalant ainsi que cette activité constitue un volet essentiel de sa mission.
Au moment de l’arrivée au pouvoir des Libéraux de Jean Lesage en 1960, une nouvelle vague d’investissements dans l’industrie manufacturière, la nationalisation de l’ensemble des compagnies productrices d’hydro-électricité et la création de plusieurs sociétés d’État dans le secteur des richesses naturelles ouvrent de nouvelles voies pour les diplômés de Polytechnique. Par ailleurs, le gouvernement québécois et celui du Canada, tout comme la Ville de Montréal, injectent des sommes substantielles dans des projets d’envergure (métro de Montréal, Expo 67, modernisation du système routier, etc.). Plus important encore, la construction des grands barrages à Manicouagan et à la baie James permet à des firmes d’ingénieurs québécoises, créées par des diplômés de Polytechnique, de participer et d’acquérir une expertise propice à la conquête de marchés internationaux. C’est le cas notamment de SNC et de Lavalin (aujourd’hui SNC-Lavalin). D’autres firmes au rayonnement international comme Cogeco, fondée par un ancien de Poly, ou Bombardier, qui regroupe un large bassin de polytechniciens, témoignent de l’apport de l’établissement montréalais. Dorénavant plus nombreux au Québec que leurs compatriotes anglophones, les ingénieurs francophones accèdent massivement aux postes supérieurs des grandes entreprises privées.
Polytechnique d’hier à aujourd’hui, ici et dans le monde
À la fin du premier quart du XXIe siècle, Polytechnique trône parmi les grandes écoles de génie dans le monde. Elle pilote nombre de projets de recherche qui totalisent annuellement plus de 100 millions de dollars. Elle entretient des collaborations avec pas moins de 300 partenaires industriels aussi bien au Canada qu’à l’étranger. Parmi eux, de grandes sociétés dans des secteurs de pointe tels l’aérospatiale, le biomédical, l’énergie, l’intelligence artificielle et les télécommunications. Enfin, Polytechnique accueille aujourd’hui 10 000 étudiants dont 30 % sont des femmes. La communauté étudiante n’est pas restée passive tout au long des trois siècles qu’a connus l’établissement. L’Association des étudiants de Polytechnique est créée dès la fin du XIXe siècle. Le bal des finissants, les initiations, les carnavals font ensuite leur apparition et contribuent à développer un esprit de corps souvent absent dans d’autres universités. La publication des journaux étudiants, de La Hache au Polyscope, l’initiative heureuse de la création de la coopérative étudiante Coopoly, l’appui de l’Association étudiante aux grandes revendications sociales et politiques des années 1960 et 1970 sont autant d’autres manifestations de l’implication de ceux et celles qui ont étudié à Polytechnique.
Comme on peut le voir, Polytechnique en a fait du chemin depuis ses cinq premiers finissants au printemps 1877. Peu de gens, à l’époque, auraient cru que cette nouvelle école franchirait le siècle qui l’avait vu naître. Son fondateur, Urgel-Eugène Archambault, lui, avait anticipé que son école de génie viendrait à bout des nombreux obstacles qu’elle rencontrerait. Peut-être n’avait-il pas rêvé à un aussi bel avenir. Gageons que s’il revenait sur terre aujourd’hui, il n’en croirait pas ses yeux!
Robert Gagnon est professeur au Département d’histoire de l’UQAM et membre du Centre interuniversitaire de recherches sur la science et la technologie (CIRST). Il a écrit plusieurs livres, dont Histoire de l’École Polytechnique de Montréal : la montée des ingénieurs francophones (Boréal, 1991), Urgel-Eugène Archambault : une vie au service de l’instruction publique (Boréal, 2013) et Augustin Frigon : sciences, techniques et radiodiffusion (Boréal, 2019).


 disponible (Hiver 2023)
disponible (Hiver 2023)

