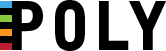
Le Magazine de Polytechnique Montréal
Louise Millette, stratège intègre du développement durable
Portrait de professeure

Pre Louise Millette, Département des génies civil, géologique et des mines
« On ne nous avait jamais dit cela avant » : cette phrase, la Pre Louise Millette l’a entendue plus d’une fois au cours de sa carrière. Connue pour sa détermination peu commune et son franc-parler, elle n’a jamais hésité à faire bouger les lignes des organisations pour favoriser une meilleure réponse sociale et environnementale aux grands enjeux de la société. À l’heure de fermer le chapitre sur ses six mandats à la direction du Département des génies civil, géologique et des mines – un record pour un tel poste à Polytechnique – elle revient sur son parcours singulier.
Naissance d’une vocation
Issue d’un milieu ouvrier modeste, Louise Millette est la première de sa famille à entrer à l’université. « Ma famille n’avait pas les moyens de me payer des études. Je suis un pur produit des prêts et bourses », souligne-t-elle. La brillante élève, qui excelle en sciences et mathématiques, des disciplines dont le côté « carré » correspond à son esprit cartésien, se dirige d’abord vers des études en physique quantique à l’Université de Montréal. Mais si la matière lui plaît, elle s’aperçoit que les débouchés lui permettraient difficilement de réaliser son rêve d’agir pour améliorer la société. « Travailler pour la Défense, comme la plupart des étudiants de ma classe s’y destinaient, ne correspondait pas à ma vision du changement que je souhaitais apporter dans la société. Par ailleurs, il était important pour moi que ma future profession me procure un bon salaire, car je connaissais trop bien la précarité. »
Comment concilier ces aspirations? C’est un paysage familier qui lui fournit la réponse : « Je résidais à Laval, et je longeais quotidiennement la rivière des Prairies. À l’époque – on parle des années 70 –, celle-ci était un égout à ciel ouvert, entourée d’un tissu urbain qui se développait de façon anarchique. Agir en faveur de l’environnement, voilà une mission qui me correspondait. Et quelle discipline, sinon le génie civil, pouvait me permettre de la réaliser, tout en m’assurant un bon salaire? »
Elle entame ses études de baccalauréat en génie civil à l’Université de Sherbrooke, en raison du programme coop lui permettant de travailler pour financer ses études. Revenue à Montréal pour des raisons familiales, elle intègre Polytechnique pour terminer son baccalauréat, non sans quelques appréhensions. « Au cégep, je lisais parfois Le Polyscope et le récit des initiations me rebutait. Or, j’ai trouvé un milieu très accueillant à Polytechnique, ainsi que des possibilités uniques de progresser vers mon objectif. » Polytechnique lance en effet cette année-là sa nouvelle orientation en génie de l’environnement dans son programme de génie civil, une voie parfaite pour Louise Millette, qui termine majeure de sa promotion.
La jeune diplômée réalise un stage de recherche en environnement dans le laboratoire du Pr Raymond Desjardins dans le cadre du programme UPIR (Unité de participation et d’initiation à la recherche) tout juste créé. Elle constate que la recherche exige avant tout un travail acharné, rien qui ne puisse intimider cette bûcheuse. De plus, le marché de l’emploi n’étant pas favorable à ce moment-là pour les ingénieurs civils (la Baie-James venait de terminer sa première phase), poursuivre aux études supérieures apparaît un choix pertinent. Encouragée par le Pr Desjardins, elle obtient une bourse d’excellence et s’inscrit à une maîtrise en traitement des eaux à l’Université de la Colombie-Britannique, à Vancouver, afin de voir du pays et de parfaire son anglais.
Expérience nordique imprévue
Peu de temps après son arrivée en Colombie-Britannique, elle reçoit un appel surprenant d’un chercheur croisé au laboratoire de Raymond Desjardins. Celui-ci l’informe que son équipe, qui réalise des projets en environnement à Fort Chimo (aujourd’hui Kuujjuaq) au Nord-du-Québec, cherche quelqu’un pour réaliser un mandat subventionné en conservation d’énergie. Organisée, bilingue et aventurière, Louise Millette lui semble taillée pour ce mandat. Au grand dam de ses professeurs, celle-ci met en suspens sa maîtrise, perdant sa bourse par la même occasion, et part s’installer pour un an dans le Grand Nord, au cœur d’une communauté de 252 habitants.
« Le projet, mené en partenariat avec le gouvernement du Québec, Hydro-Québec et la Société d’habitation, consistait à expliquer à la population autochtone comment réduire les dépenses d’énergie dans son habitat. Les maisons anciennes, construites par le gouvernement canadien pour les Inuits, ne respectaient pas les normes d’isolation thermique. Je montrais aux gens comment rendre leurs habitations plus confortables et moins énergivores en les calfeutrant et en réduisant les infiltrations. Mes relations avec cette communauté furent excellentes et cette expérience dépaysante m’a permis de déboulonner les mythes sur le mode de vie des Inuits. »
Oser bousculer les cultures organisationnelles
Son mandat achevé, elle retourne à Vancouver pour terminer sa maîtrise, puis elle revient faire un doctorat à Polytechnique. « Quel bonheur de mener mes expérimentations! », se souvient-elle. Un an avant l’obtention du diplôme, sa bourse doctorale prend fin, il lui faut trouver un emploi. « J’ai postulé chez Bell qui ouvrait un poste lié à l’environnement, mais l’entreprise estimait impossible de m’accorder un emploi à temps partiel pour me permettre d’achever mon doctorat. Trois mois plus tard, le poste restant vacant, je suis revenue à la charge. Cette fois, je les ai convaincus, même si cet arrangement était "très inhabituel" m’ont-ils souligné, et qu’ils me trouvaient un peu inexpérimentée. »
Dans ces années 90, Bell, comme toutes les entreprises, doit revoir ses processus en vue de se conformer aux règlements prévus par la Loi sur l’environnement. Poser un diagnostic sur les activités, préparer des plans et les mettre en œuvre, bâtir une équipe, accompagner le changement : tout est à faire. Mme Millette relève le défi avec sa ténacité coutumière. « Je les ai prévenus que mes actions ne seraient pas une opération d’éco-blanchiment. »
Elle demeure chez Bell bien au-delà de la fin de son doctorat, heureuse d’implanter des considérations environnementales au sein des structures de l’entreprise. Mais au début de la nouvelle décennie, le marché des télécoms dorénavant ouvert à la compétition implique des compressions de personnel et une course au rendement accélérée. Mme Millette ressent l’envie d’autres horizons. Lors d’une partie d’huîtres de l’Association des diplômés, elle apprend que le poste de direction du CGM est ouvert. Tournant le dos à une prestigieuse carrière chez Bell, elle présente sa candidature, qui est refusée, car son parcours est jugé trop atypique. Mais on ne dit pas aisément non à Louise Millette. « J’ai envoyé une lettre au conseil d’administration pour faire valoir mes compétences et mes motivations. Les membres ont accepté de me rencontrer, même si c’était, là encore, "très inhabituel" selon leurs termes. Et j’ai obtenu le poste. »
Mme Millette devient ainsi en 2002 la première femme directrice de département de Polytechnique. À l’époque, de sévères coupes dans les subventions publiques en éducation mettent à mal le budget de l’établissement. Le Département CGM, quant à lui, ne recrute pas assez d’étudiants pour répondre aux besoins de l’industrie. Une nouvelle fois, Mme Millette met à profit sa capacité à poser un diagnostic, ainsi que sa force de conviction. Elle fédère son équipe dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour rendre la formation en phase avec les attentes des nouvelles générations étudiantes.
Instaurer la pensée du développement durable à Polytechnique et dans la société
« La société prend de plus en plus conscience des impacts environnementaux et sociaux des décisions prises par les ingénieurs. Il nous incombe de développer la responsabilité environnementale de la relève en génie et de lui donner de meilleures connaissances en développement durable », déclare la Pre Millette, dont la présence à diverses tables de concertation à Polytechnique et au pays contribue à transformer la formation des ingénieurs en ce sens.
Sous son impulsion, sont créés à Polytechnique l’orientation thématique en développement durable ainsi que le projet intégrateur en développement durable, aujourd’hui ouvert aux étudiants de tous les programmes de baccalauréat.
Polytechnique doit entre autres aux actions de Mme Millette l’élaboration de sa première politique en matière d’environnement en 2004, la constitution du comité de gestion environnementale, la création du Bureau du développement durable, la création du cours en ligne gratuit « L’ingénieur, source de solutions durables », ainsi que l’obtention du niveau Or de l’accréditation internationale Sustainable Tracking Assessment & Rating System (STARS) mesurant la performance en durabilité d’établissements d’enseignement supérieur du monde entier.
Appréhender le temps long du changement
Les étudiants sont très soucieux aujourd’hui des questions environnementales; ils veulent jouer un rôle actif dans le changement, constate Louise Millette. Certains craignent de vendre leur âme au diable en allant travailler pour l’industrie. Elle veut les rassurer : le changement n’est pas l’enjeu d’un bras de fer, mais le résultat d’une négociation. Il faut donc se montrer stratégique et tenace, estime-t-elle.
Une attitude qui vaut aussi pour les nouvelles préoccupations de la société, comme l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI), pense la professeure, qui siège au comité EDI de Polytechnique. « On ne peut nier ni minimiser les impacts de la discrimination sur une personne et sur sa carrière. Pourtant, c’est un exercice délicat de faire reconnaître l’existence de biais systématiques et d’une iniquité de traitement dans une organisation. Il faut sensibiliser sans heurter et parvenir à convaincre que créer des conditions plus équitables ne nuit pas à l’excellence. Parfois aussi, c’est en croyant bien faire qu’un gestionnaire embauche systématiquement des gens sortis du même moule que les autres membres de son équipe. L’idée qu’en étant homogène, l’équipe travaillera forcément mieux, est présente même dans les universités et doit être déconstruite patiemment. »
Fidèle à la mission qu’elle s’est donnée, Mme Millette souhaite dorénavant s’investir plus intensivement dans le Bureau du développement durable et demeurera membre du comité du développement durable. « Faire grandir la pensée développement durable à Polytechnique aidera nos futurs ingénieurs et ingénieures à comprendre qu’on ne change pas le monde avec des technologies mais avec des personnes. C’est leur façon d’agir qui transformera la société. »


 disponible (Été 2021)
disponible (Été 2021)


