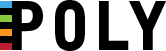
Le Magazine de Polytechnique Montréal
Les valeurs, plus que de simples paroles!

(Photo : Avril Franco)
Dans le cadre de la planification stratégique, le regard se pose sur les valeurs de notre établissement. D’emblée, il faut reconnaître que l’exercice n’est pas simple, en ceci que les valeurs portent toujours le risque d’être en tension ou, dans le pire des cas, en conflit avec celles déjà reconnues et incarnées. S’il est une chose en éthique qui peut paraître insaisissable et ésotérique, ce sont les valeurs. Pourtant, elles sont à la base de plusieurs de nos discours, actions et décisions, que l’on s’en rende compte ou pas.
Alors, qu’est-ce qu’une valeur? D’où proviennent les valeurs? Comment identifier les nôtres?
Guy Durand, professeur émérite en éthique de l’Université de Montréal, définit la valeur comme quelque chose que tout le monde cherche et veut – bref, désirable et universel – relevant du vrai, du bon et du bien. Les valeurs se distinguent des principes qui guident l’action avec plus de précision et des règles qui explicitent concrètement les actions. Par exemple, la dignité humaine serait une valeur de laquelle découle le principe du respect de l’autonomie de la personne menant à la règle du consentement libre et éclairé. L’ennui avec cette définition des valeurs, c’est que plusieurs concepts peuvent en revendiquer le statut.
Or, ce qui est désirable et universel dépend de notre culture, de la société dans laquelle nous évoluons, de nos expériences, de nos relations, de notre champ d’expertise, etc. Dès lors, ne pourrions-nous pas affirmer que toutes les valeurs s’équivalent? C’est ce que l’on appelle le relativisme moral; une source intarissable de conflits. Existe-t-il alors un système de valeurs qui puisse être universel et compatible avec un maximum d’êtres humains, quelles que soient leur trajectoire de vie, leur culture, etc.?
C’est le projet du chercheur en psychologie sociale Shalom H. Schwartz et sa théorie des valeurs universelles humaines. Grosso modo, il cherche depuis plusieurs décennies à définir les valeurs qui sont transversales aux cultures. Schwartz définit les valeurs comme des formes de croyance inconscientes qui surgissent dans l’action, sont hiérarchisables, servent à mesurer les actions des autres et nous orientent vers nos intérêts personnels et sociétaux. Il précise que nous pouvons découvrir nos propres valeurs – héritées de nos diverses relations et expériences – lorsqu’elles entrent en conflit avec celles des autres.
Affinée auprès de dizaines de milliers de participants, sa théorie comprend une douzaine de valeurs phares, soit l’autodétermination, la stimulation, l’hédonisme, l’accomplissement, le pouvoir, la réputation, la sécurité, la tradition, la conformité, l’humilité, l’universalisme et la bienfaisance. Schwartz reconnaît d’emblée que certaines valeurs sont en tension naturelle, comme le pouvoir et la bienfaisance envers autrui, la tradition et l’autodétermination ou encore l’accomplissement et l’humilité.
Mais à quoi peut servir cette théorie dans la pratique?
Un exemple simpliste est celui d’un chercheur affirmant qu’une règle particulière entrave sa liberté universitaire. Si on décortique cette affirmation, on peut y déceler la ligne de tension entre les valeurs de conformité et d’autodétermination. On comprend alors que, pour cette personne, son autonomie est une valeur fondamentale; ce n’est pas qu’elle soit contre la règle, mais son autonomie a préséance. Les valeurs – et leur analyse – permettent donc de mieux comprendre les autres en identifiant leurs motivations fondamentales et ce qui les rebute.
Concernant nos prochaines valeurs polytechniciennes, la question est donc de savoir si elles seront universelles, désirables et pourront guider nos actions, discours et décisions. Surtout, de quelles valeurs identifiées par Schwartz seront-elles proches : pouvoir, réputation, accomplissement, autodétermination, conformité, stimulation, hédonisme, tradition, bienfaisance, etc.?
Bref, les valeurs ne sont pas des mots vides de sens, ésotériques et inspirants; elles portent le pouvoir de communiquer avec autrui, de mieux le comprendre ou de se l’aliéner. Comme dans la chanson Paroles... Paroles... interprétée par Dalida et Alain Delon, les valeurs portent toujours le risque de devenir « des mots magiques des mots tactiques qui sonnent faux », « [d]es mots tendres enrobés de douceur » qui « se posent sur [la] bouche, mais jamais sur [le] cœur ».
Références
- Durand, G. (1999). Introduction générale à la bioéthique. Histoire, concepts et outils. Montréal: Fides/Cerf.
- Schwartz, S. H. (2012). « An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. » Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 20. doi:https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116
- Schwartz, S. H., Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Fischer, R., Beierlein, C., . . . Konty, M. (2012). « Refining the theory of basic individual values. » (A. P. Association, Éd.) Journal of Personality and Social Psychology, 103(4), 663-688.
- Ferrio, G. (compositeur), Chiosso, L. et Del Re, G. (paroliers) (1972). Parole parole (version originale italienne enregistrée en 1972), Lugano (Suisse). (Reprise par Dalida et Alain Delon en 1973)
En bref
- Les valeurs, bien que parfois perçues comme insaisissables, sont fondamentales dans nos discours, actions et décisions.
- Les valeurs, différentes des principes et des règles, peuvent varier en fonction de la culture, de la société, des expériences individuelles, etc. Toutefois, il existe une théorie des valeurs universelles humaines, identifiant une douzaine de valeurs transversales aux cultures.
- Les valeurs constituent des éléments puissants de communication et de compréhension mutuelle.


 disponible (Automne 2023)
disponible (Automne 2023)
