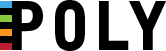
Le Magazine de Polytechnique Montréal
Les enjeux actuels de l’enseignement virtuel
Grand dossier
Depuis mars dernier, l’enseignement à distance s’est imposé comme mode de formation dominant à Polytechnique Montréal. Ses équipes pédagogiques se livrent à une réflexion intensive sur les meilleures façons d’assurer une continuité et une juste évaluation des apprentissages. Des représentants de ces équipes témoignent ici de l’apport des ressources technopédagogiques, de leurs interrogations et de leur perception du nouveau visage de l’enseignement qui est en train de se dessiner à Polytechnique.

Une année universitaire à hauts défis
Après le tsunami du confinement en mars dernier, les équipes de direction de toutes les universités du pays ont affronté une déferlante de questions : poursuivre ou annuler le trimestre ? Comment ? Que faire au sujet des évaluations ?

Pr Pierre Baptiste, directeur adjoint à la formation et la recherche
« Le climat de confiance établi entre l’équipe de direction, les enseignants, les associations étudiantes et les services a facilité la prise de décisions et leur mise en application », rapporte le directeur adjoint à la formation et à la recherche, le Pr Pierre Baptiste. Celui-ci a tenu à ce que les chargés de cours participent eux aussi au processus décisionnel. « Nous devions prendre en considération leur situation particulière et leur regard extérieur », indique-t-il.
La poursuite du trimestre ayant été décidée, en deux semaines, Polytechnique a fait basculer en ligne l’essentiel des cours de ses programmes. « Pour réaliser cette mutation, nous avons tiré profit de l’expérience de Polytechnique en matière de formation à distance acquise grâce à ses programmes de certificat, ainsi que de l’expertise de l’équipe du Bureau d’appui et d’innovation pédagogique », précise le Pr Baptiste.
Par ailleurs, pour terminer le trimestre d’hiver en veillant à ne pas ajouter de stress à une population étudiante déjà éprouvée, Polytechnique a trouvé une variété de solutions, dont différents types d’épreuves en ligne ou encore la substitution de certains examens par des travaux à la maison. Le Pr Baptiste ne manque pas de faire valoir l’ampleur des efforts fournis par les enseignants au cours de ces derniers mois pour produire le matériel de qualité nécessaire à la continuité des cours.
Le comité de continuation de l’enseignement créé dans le contexte de la pandémie s’est assuré que différentes ressources ainsi que du soutien technique et technopédagogique soient offerts aux enseignants pour terminer le trimestre d’hiver ou pour les aider à transformer leur cours afin que tout soit prêt pour l’été et l’automne 2020. Les défis restent cependant nombreux.
Maintenir la qualité des évaluations : un délicat numéro d’équilibre
« L’évaluation des apprentissages et des compétences des étudiants demeure un énorme enjeu », confie le Pr Baptiste, préoccupé par l’organisation des examens de la fin du trimestre actuel. « L’évaluation est essentielle à notre mission universitaire. Nous avons exploré toutes les avenues possibles pour nous assurer de l’acquisition des apprentissages, avec la rigueur attendue d’une université d’ingénierie telle que la nôtre. »
Le passage de Montréal en zone rouge, le 8 octobre, complique la tenue des épreuves en environnement contrôlé. Tous les examens finaux du trimestre en cours se tiendront en présentiel, impliquant au besoin la location d’espaces hors des murs de Polytechnique. « La surveillance à distance avec des outils technologiques pouvant être perçus comme intrusifs se cantonnera uniquement aux situations incompatibles avec le présentiel, par exemple, si la tenue des examens en présentiel était interdite par les autorités sanitaires. Dans ces cas de figure, Polytechnique s'est engagée à restreindre la surveillance à l’utilisation d’une seule caméra et à conserver les vidéos le moins longtemps possible, et seulement sur le territoire national », précise Pierre Baptiste.
« Nous savons qu’aucune solution ne pourra obtenir l’adhésion unanime de notre communauté, mais nous agissons avec transparence envers nos étudiants, qui sont représentés dans les comités décisionnels et que nous tenons informés des enjeux. »
Le Pr Baptiste estime que c’est non seulement la formule, mais le paradigme lui-même des évaluations qui devra évoluer si le contexte pandémique venait à perdurer. « L’approche pourrait se concentrer davantage encore sur la compréhension et l’analyse des phénomènes étudiés en génie. Nous avons certainement besoin d’une réflexion collective à ce sujet. »
Préserver le présentiel autant que possible
Le Pr Baptiste se préoccupe vivement de la situation des étudiants entrés à Polytechnique l’an passé. « Combien de trimestres “normaux” comprendra leur parcours à Polytechnique ? Nul ne peut le dire à l’heure actuelle. Je me soucie en particulier des difficultés des étudiants qui risquent de passer sous le radar. En temps ordinaire, les enseignants qui sont face à leurs étudiants dans leur salle de cours sont les premiers à détecter leurs difficultés. Avec l’enseignement à distance, on perd quelque peu cette capacité. »
Pour préserver le lien avec les étudiants et leur assurer l’expérience pratique si essentielle à leur formation en génie, le Conseil académique a maintenu des cours en présentiel. Le choix s’est porté sur les cours requérant du travail en équipe, tels que ceux sur les habiletés personnelles et relationnelles ou les projets intégrateurs. « J’ai eu l’occasion de visiter une classe où se tenait un de ces cours, l’enthousiasme des étudiants à travailler en équipe et rencontrer des enseignants m’a confirmé que c’était assurément une bonne décision », ajoute le Pr Baptiste.
Virage technopédagogique à toute vapeur dans les départements
Le virage vers de nouvelles méthodes ou approches pédagogiques, déjà amorcé dans les départements sous l’impulsion d’initiatives individuelles, a connu une accélération phénoménale. Aidés par l’équipe du Bureau d’appui et d’innovation pédagogique (BAIP), les enseignants se sont mis à pied d’oeuvre pour repenser la structure de leurs cours afin d’en produire une version numérique.

Pr Pierre Langlois, directeur du Département de génie informatique et génie logiciel
En matière d’audience, les résultats sont à la hauteur des efforts. En effet, dans certains programmes, on a eu l’agréable surprise de constater une participation record aux cours donnés à distance. « Libérés des contraintes de déplacement, les étudiants sont sans doute plus enclins à assister aux cours », pense le Pr Pierre Langlois, directeur du Département de génie informatique et génie logiciel.
Le Département GIGL se trouvait particulièrement bien équipé pour réaliser avec succès le transfert vers l’enseignement à distance, estime-t-il : « Du point de vue technologique, nous ne manquions pas de références, beaucoup de nos professeurs mènent leurs travaux de recherche sur des concepts avancés d’infonuagique. Sur le plan matériel, la plupart de nos travaux pratiques peuvent se dérouler à distance. Nos techniciens ont mis en place des solutions pour partager l’accès à certains équipements tels que des logiciels spécialisés. Quant à nos étudiants, ils possédaient déjà tous un ordinateur personnel, c’est une obligation pour leur programme. En revanche, au même titre que tous les autres départements, nous sommes affectés par la perte du contact humain direct avec nos étudiants. »
Grâce à l’utilisation du tableau lumineux, le Pr Langlois se réjouit de pouvoir donner cet automne un cours se rapprochant de son enseignement en classe. « Mais sans la rétroaction constante du langage corporel des étudiants, j’admets que c’est un peu insécurisant. J’ai une pensée pour les annonceurs de télévision! », plaisante-t il.
L’expertise de la Chaire IMPACTG mise à contribution au département de génie chimique
Au Département de génie chimique, le maître d’enseignement et titulaire de la Chaire Innovation en moyens pédagogiques d’apprentissage actif en génie (IMPACTG), Patrice Farand, est sur tous les fronts. Il aide autant les professeurs que les étudiants dans la transition vers l’enseignement à distance, leur fournissant conseils et outils pour atteindre leurs objectifs durant cette année si particulière.

Patrice Farand, titulaire de la Chaire IMPACTG
Ses initiatives comprennent la création du Comité d’implantation de l’enseignement en ligne (CIEL), dès la mi-mars. Réunissant des professeurs, des étudiants, des techniciens et la coordonnatrice académique département, ce comité a pour mission d’aiguiller l’équipe professorale et les étudiants du département dans le nouveau contexte de formation à distance.
Patrice Farand a produit également une série de vignettes de conseils pour aider les professeurs à planifier la session d’automne. Il a organisé des ateliers avec des spécialistes et offre un accompagnement individualisé aux professeurs. « Aujourd’hui, l’ensemble des professeurs ont découvert ce qu’implique la production de matériel adapté pour les cours à distance. Par exemple, plus de 500 capsules ont été créées au département. Je peux dire que nous avons fait un bond en avant d’au moins 10 ans en matière d’approches en pédagogie », affirme-t-il.
Enfin, pour favoriser l’encadrement et le sentiment d’appartenance des étudiants cet automne, il a mis sur pied une journée d’accueil interactive, ainsi qu’une activité de rencontres éclair. Cette activité aide les nouveaux étudiants à faire connaissance et à se trouver des coéquipiers pour leurs futurs travaux. Son équipe a aussi créé le programme d’accompagnement virtuel des étudiantes et des étudiants en génie chimique (AVEC), qui prévoit le jumelage de chaque nouvel étudiant avec un étudiant plus avancé. Enfin, il a établi le Bureau virtuel d’accompagnement académique des étudiantes et des étudiants en génie chimique (BUVAAC) permettant d’offrir un encadrement personnalisé.
« Ces initiatives visent à aider nos étudiants à s’organiser dans leurs apprentissages et à renforcer leur sentiment d’appartenance à la grande famille du génie chimique de Polytechnique, car ils vivent actuellement beaucoup de solitude », commente Patrice Farand. « Cela dit, même s’ils n’en ont pas encore pris conscience, ils développent en ce moment leur autonomie et leur sens de l’organisation à vitesse grand V. »
Les sondages conduits par le Département de génie chimique montrent que professeurs et étudiants apprécient le soutien qui leur est apporté et qu’ils sont globalement satisfaits de leur expérience cet automne.
Des ressources d’une grande richesse pour les enseignants
Les professeurs engagés dans la transformation de leurs cours peuvent compter sur l’indispensable soutien du Bureau d’appui et d’innovation technologique (BAIP), qui a déployé à leur intention toute une panoplie d’ateliers, de webinaires, d’outils pratiques et de conseils spécialisés pour faciliter leur démarche.

Lina Forest, directrice du Bureau d’appui et d’innovation technologique (BAIP)
« Depuis plus de 40 ans que nos services existent, nous n’avions jamais vu une telle participation à nos activités de formation : plus de 370 enseignants ont assisté à une de nos formations ou l’ont regardé en différé », remarque Lina Forest, la directrice du BAIP. « Nos ateliers, plus d’une quarantaine offerts depuis mars, sont très populaires et la demande de conseils personnalisés a explosé. »

Judith Cantin, conseillère pédagogique au BAIP
Selon Judith Cantin, conseillère pédagogique ayant assuré l’intérim à la direction du BAIP au début de la pandémie, « la crise de la COVID n’a pas été qu’une période de chaos, elle a aussi été une occasion d’accélérer le changement dans l’enseignement. Et le changement, c’est notre carburant! »
Tous les professeurs n’ont pas eu à gravir la même marche : certains avaient déjà exploré avec succès des approches pédagogiques et de nouveaux outils technologique. Ils avaient donc déjà préparé des ressources en ligne prêtes à utiliser. D’autres étaient novices en matière d’usage des plateformes collaboratives ou de l’art d’enseigner à distance en mode synchrone ou asynchrone, et ils ont construit leurs cours en ligne à partir de zéro.
« En s’initiant à d’autres modes de diffusion, les enseignants se sont mis à réfléchir sur le design de leurs cours, dans le but de tirer le meilleur parti possible d’une combinaison rencontres virtuelles (synchrone) avec les étudiants et de ressources en ligne », constate Judith Cantin, qui prévoit une certaine tendance à l’hybridation pour les cours à venir.
Vers une généralisation des modes de diffusion et de nouvelles approches en enseignement?
L’adaptation de l’enseignement qui s’est opérée brusquement peut être déstabilisante pour les enseignants et les étudiants, et elle soulève des questions encore sans réponse. Cependant, elle se révèle aussi porteuse de nouvelles façons de faire apprendre et d’apprendre. Les professeurs et spécialistes cités plus haut s’accordent à penser qu’elle débouchera sur des situations d’apprentissage améliorées qui perdureront une fois la crise surmontée.
« Une offre de cours hybrides est sans doute appelée à se développer, afin de proposer aux étudiants une formule souple plus adaptée à leurs besoins et leurs modes d’apprentissage », envisage le Pr Baptiste. Son collègue le Pr Langlois ajoute qu’il s’attend à ce que la classe inversée (cours à la maison et exercices et projets appliqués en classe) soit plus répandue, apportant des gains de qualité et d’efficacité dans les apprentissages.


 disponible (Automne 2020)
disponible (Automne 2020)

