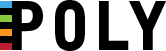
Le Magazine de Polytechnique Montréal
L’enchantement du savoir scientifique
Point de vue

Jean Dansereau vient de recevoir de Polytechnique le titre de professeur émérite. Il nous livre son témoignage d’une féconde carrière de chercheur, d’enseignant et d’administrateur universitaire.
Les yeux d’un ingénieur sur le vivant
À Polytechnique, le nom de Jean Dansereau est étroitement associé au domaine de la biomécanique et de l’ingénierie de la réadaptation, dont il a contribué à faire un axe majeur du génie biomédical à Polytechnique en partenariat avec le CHU Sainte-Justine. Comment s’est développé cet intérêt chez lui? « J’ai toujours été passionné à la fois par le vivant et par la mécanique, rapporte le professeur. Quand j’étais jeune, j’adorais me rendre à la scierie de mon père, tant la machinerie de l’usine me fascinait. »
Vers la fin de son baccalauréat à Polytechnique en génie mécanique, en 1981, il assiste à des séminaires animés par le Pr Gilbert Drouin sur les différents aspects de la biomécanique, qui lui donnent envie de se diriger vers ce domaine. Sa maîtrise, obtenue à Polytechnique en 1983, combine à la fois les aspects du génie mécanique, du génie biomédical et ce qu’on appelle aujourd’hui le génie orthopédique. Ensuite, il s’engage dans un doctorat visant l’étude biomécanique des déformations de la colonne vertébrale et de la cage thoracique à l’Université du Vermont aux États-Unis.
En 1986, Jean Dansereau revient à Polytechnique pour démarrer sa carrière de professeur au Département de génie mécanique. Peu de temps après, l’idée de former à Montréal une équipe de recherche interdisciplinaire pour l’étude des déformations de la colonne vertébrale germe… sur un terrain de golf. « J’assistais à une conférence à Pointe-au-Pic, à laquelle était présent le Dr Hubert Labelle, chirurgien orthopédiste et spécialiste des traitements des scolioses à l’Hôpital Sainte-Justine. Nous avons entamé une partie sur le green local, discutant en même temps de possibilités d’allier nos compétences scientifiques. L’idée a fait son chemin et j’ai ensuite eu la chance de rencontrer le Pr Jacques de Guise, de l’ÉTS, un expert en imagerie biomédicale, avec qui nous avons développé une complicité extraordinaire. Notre équipe interdisciplinaire était formée! Nos projets de recherche conjoints ont obtenu à la fois du financement des organismes subventionnaires provinciaux et fédéraux tant en génie que du domaine de la santé. »
À l’époque, le domaine de la biomécanique est encore assez mal connu. Mais l’équipe formée par Jean Dansereau parvient à établir un langage commun entre les disciplines de la biomécanique, de l’imagerie biomédicale, de la reconstruction/modélisation 3D, de la conception assistée par ordinateur (CAO) et de l’orthopédie. Elle acquiert rapidement une reconnaissance nationale et internationale. À Polytechnique, de brillants étudiants viennent travailler sous la direction du Pr Dansereau, dont un certain Carl-Éric Aubin.
« Notre équipe a démarré dans un tout petit laboratoire, mais en quelques années, nous occupions un demi-étage complet à Sainte-Justine, rapporte le Pr Dansereau. Nous avons été la première équipe au monde à représenter en 3D, avec des outils de CAO, l’évolution des déformations de la colonne vertébrale et du tronc. »
Ce travail de modélisation lui fait prendre conscience de l’extrême complexité de la structure du squelette et du corps humain. Comme en témoignait un de ses anciens étudiants, diplômé à la maîtrise et employé chez Bombardier : « C’est vrai que c’est difficile de modéliser un avion, mais modéliser un corps humain, c’est vraiment plus compliqué! »
En 1996, les activités du Pr Dansereau s’orientent davantage vers l’ingénierie de la réadaptation : il obtient une chaire industrielle sur les aides techniques à la posture soutenue par Orthofab, une PME québécoise d’équipements en réadaptation. « Les projets de la Chaire visaient la conception d’éléments de positionnement pour les personnes en fauteuil roulant. C’est dans ce contexte que Carl-Éric Aubin est engagé, comme professeur adjoint à Polytechnique, pour reprendre le flambeau de la recherche sur la scoliose. »
Virage vers l’administration universitaire
Au tournant du siècle, malgré les succès scientifiques de la Chaire, le financement de celle-ci s’estompe. C’est l’occasion pour le Pr Dansereau d’envisager une réorientation de sa carrière. « L’Assemblée générale des professeurs de Polytechnique m’avait déjà élu membre du Conseil académique. À la demande de ce dernier, j’ai accepté de présider un groupe de travail mandaté pour élaborer une politique d’encadrement des étudiants des cycles supérieurs. Cette politique, la première du genre au Québec, acceptée en 1999, est toujours en vigueur aujourd’hui. »
En 2001, il est nommé directeur des études supérieures et de l’encadrement. S’ouvre une période intense : refonte des règlements de l’examen de synthèse et de la durée des études aux cycles supérieurs, élaboration d’ententes de double diplôme avec de grandes écoles et universités de génie européennes, création de nouveaux programmes d’études supérieures, etc. Sous sa direction, le nombre d’inscriptions au doctorat ne cesse de croître.
Témoin et acteur d’un changement profond de la formation en ingénierie
« Un des projets les plus ambitieux que l’on m’a confiés fut mon implication, en tant que directeur adjoint de l’enseignement et de la formation, dans la refonte des programmes de baccalauréat entreprise par Polytechnique à partir de 2003 et qui s’est échelonnée jusqu’en 2008. En tant que président du comité qui veillait à l’implantation de ces nouveaux programmes, j’assistais au renouvellement de la vision de la formation en ingénierie : on parlait de compétences transversales, de stages obligatoires en entreprises, d’évaluation des apprentissages, de nouvelles approches pédagogiques… C’était fantastique! La qualité de l’encadrement et la rétention des étudiants sont devenues alors de grandes priorités. Ce fut un grand chantier pour toute la communauté de Polytechnique et je suis fier d’y avoir apporté ma contribution! »
Mais l’implication de Jean Dansereau déborde le cadre de Polytechnique. En 2009, il lance un chantier sur l’état de la structure de la maîtrise au Québec dans le cadre des activités de l’ADÉSAQ (Association des doyens des études supérieures au Québec) qui produit deux rapports sur le sujet, qui ont eu des répercussions dans l’ensemble des universités québécoises. Par la suite, il est nommé vice-président, puis président de cette association universitaire provinciale.
À Polytechnique, il met en place, en collaboration avec le Pr Jean Nicolas, expert réputé en pédagogie dans l'enseignement supérieur, une initiative alors unique au Québec : les ateliers crédités de formation complémentaire au doctorat. « Obligatoires en début de formation doctorale, ces ateliers donnent aux étudiants l’occasion de s’investir et de gagner en autonomie dans leur projet de recherche », indique-t-il.
Après cinq mandats à titre de directeur des études supérieures, il réintègre le Département de génie mécanique et se consacre depuis, entre autres, à l’enseignement de plusieurs de ces ateliers. Cette activité qu’il affectionne particulièrement dépasse les frontières de Polytechnique, car l’École doctorale « Sciences du mouvement humain » conjointe entre Aix-Marseille Université, l’Université de Montpellier et l’Université de Nice l’a invité récemment à donner ce type d’atelier sous forme intensive à ses doctorants.
Savoir s’émerveiller
Jean Dansereau place l’être humain au cœur de ses préoccupations. « En tant que professeur, j’ai toujours gardé à l’esprit qu’un étudiant ou une étudiante, ce n’est pas juste une tête bien faite mais une personne humaine, qu’on doit former dans son entièreté. »
Il porte sur la démarche scientifique le même regard humaniste. « C'est profondément humain d’aller chercher la réponse à un phénomène qu’on ne comprend pas. Les scientifiques ont le mérite de ramener des parcelles de connaissances sur d’où l’on vient et où l’on va. Chaque chercheur possède au fond de lui la capacité d’émerveillement devant le mystère caché de ce qui nous entoure et nous constitue, mystère qu’il tente de toucher de ses doigts et d’élucider peu à peu. »


 disponible (Été 2021)
disponible (Été 2021)

