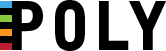
Le Magazine de Polytechnique Montréal
Le génie humanitaire

Professeur Samuel Pierre, Département de génie informatique et génie logiciel. © Ordre des ingénieurs du Québec
L’action humanitaire est souvent associée à l’image d’organismes occidentaux se portant au secours de victimes impuissantes dans les pays en voie de développement. Un cliché dépassé, estime le Pr Samuel Pierre, du Département de génie informatique et génie logiciel. Maintes fois honoré pour ses travaux sur les réseaux de télécommunications et pour son engagement humanitaire en Haïti, celui-ci promeut le « génie humanitaire », un concept récent basé sur les notions d’action éthique et de résilience.
DES SYSTÈMES EN RUPTURE
« Une crise humanitaire, c’est la rupture de l’équilibre des systèmes qui maintiennent une population dans un certain état de bien-être. Dans une perspective d’ingénieur, on souhaite agir en cas de crise en apportant des solutions pour rétablir les systèmes ou tout au moins mitiger leur rupture, afin que les populations puissent retrouver un état de bien-être durable », explique le Pr Pierre.
Cette démarche concerne toutes les populations du globe, quel que soit leur niveau de développement, précise-t-il, car la rupture des systèmes peut se produire n’importe où. « La chute de verglas qui a paralysé plusieurs villes du Québec au début avril en est un exemple. Bien que rapidement résorbée, elle nous a rappelé notre grande dépendance aux infrastructures, nous qui vivons dans une société dite riche. »
LE GÉNIE, SOURCE DE RÉSILIENCE DANS UNE ÈRE DE VULNÉRABILITÉS ACCRUES
Utilisation de drones pour fournir des données de la situation lorsque le terrain devient inaccessible, déploiement de réseau ad hoc de télécommunications, etc. : les ingénieurs ne manquent pas de solutions ni d’expertises pour pallier la destruction des infrastructures. Grâce aux données massives, ils sont en mesure de tirer des leçons des catastrophes et de concevoir des systèmes plus résilients.
« Dans notre ère de changements climatiques, les catastrophes risquent de se produire à un rythme accéléré et avec de plus grandes amplitudes. La survenue de ruptures de réseaux électriques, de réseaux de télécommunications, de distribution d’eau, etc., est prévisible et les sociétés, de plus en plus vulnérables. Les ingénieurs ont la responsabilité de développer une vision à long terme, autant sur le plan technologique que sur le plan social, pour pouvoir agir en amont », déclare M. Pierre.
En effet, viser la résilience d’une société demande de prendre en compte les facteurs humains autant que les systèmes. « Préparer les citoyens aux changements à venir, maintenir un certain niveau de bien-être quand survient une catastrophe, prêter attention aux communautés affaiblies pour qu’elles puissent survivre aux événements qui bouleversent les équilibres : ici, on entre dans un domaine encore assez peu maîtrisé par les ingénieurs, note M. Pierre. Ils ont besoin d’être formés aux interactions et au dialogue avec les parties prenantes des projets, ainsi qu’à la mobilisation des communautés. »
Renforcer la résilience d’une société requiert une approche multidisciplinaire intégrant les sciences de la santé, mais aussi des sciences humaines comme la sociologie, l’anthropologie, les sciences politiques, etc.
SAVOIR FAIRE PREUVE D’HUMILITÉ
Une catastrophe cause des problèmes d’une telle complexité, encore aggravée en cas de conflits dans les zones d’intervention, qu’il est souvent difficile d’offrir des solutions à la hauteur des attentes. « Il arrive parfois que les solutions apportées empirent une situation, car une catastrophe dénature la chaîne de décision, rappelle Samuel Pierre. En tant qu’ingénieurs, nous devons admettre que nous ne détenons pas la solution idéale, mais seulement celle créée avec le meilleur de nos capacités au moment où nous intervenons. »
VERS UNE NOUVELLE DISCIPLINE UNIVERSITAIRE?
Le Pr Pierre espère voir naître un cours spécifique sur la prise de décision en situation d’urgence, voire un programme en génie humanitaire, qui intégrerait aux connaissances en ingénierie traditionnelle celles provenant des sciences humaines et des sciences de la santé. « Une telle discipline exclut la démarche de l’assistanat. Elle ne vise pas à former des sauveurs, mais des gens capables d’équiper les communautés pour qu’elles gagnent en autonomie et en résilience. »
Lui-même initie ses étudiants à des notions relatives au génie humanitaire et constate leur vif intérêt. « Certaines questions les déroutent et les stimulent. Par exemple, comment faire la différence entre besoins réels et besoins artificiels? Elle renvoie à la question de ce qu’est être heureux. » Eh oui, il y a aussi de la philosophie dans le génie!


 disponible (Été 2023)
disponible (Été 2023)

