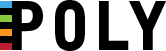
Le Magazine de Polytechnique Montréal
Catherine Beaudry, mesureuse d’innovation
Portraits de professeurs

(Photo : Caroline Perron)
Première du corps professoral de Polytechnique à devenir membre de l’Académie des sciences sociales et première femme professeure de Polytechnique à être élue à la Société royale du Canada, la Pre Catherine Beaudry, du Département de mathématiques et de génie industriel, est internationalement réputée pour ses travaux sur les processus d’innovation et leurs impacts. Elle est aussi, et avant tout, pleinement engagée pour que l’innovation technologique soit un puissant moteur de la transformation de la société.
Du génie à l’économie
Du haut de ses neuf ans, Catherine Beaudry l’affirmait bien fort : elle deviendrait ingénieure... et jouerait du violon. Un vœu de carrière bien accueilli dans son milieu familial où les études universitaires étaient valorisées (grand-père et oncles ingénieurs, parents anthropologues de formation) et qui lui avait transmis le goût de l’effort. « Quant au violon, après avoir travaillé au corps mes parents pendant trois ans, j’en ai reçu un comme cadeau de début de secondaire », mentionne Catherine Beaudry, qui a cofondé l’orchestre de chambre Sérénade en 1989 avec lequel elle joue encore à l’occasion.
Tout au long de sa scolarité, la jeune fille se démarqua par ses performances. Quand, fidèle à son vœu, elle entreprit un baccalauréat en génie électrique spécialisé en technologies spatiales à Polytechnique, elle collectionna un nombre impressionnant de bourses et de prix, dont la Médaille d’or d’Arthur Surveyer pour avoir obtenu la meilleure moyenne générale de tous les finissants de Polytechnique. « J’avais un côté nerd très assumé! », évoque-t-elle aujourd’hui, s’amusant encore d’avoir été mentionnée dans un article parodique du Polyscope, paru dans le numéro spécial des 25 ans du journal étudiant. « Ils m’ont décerné "l’Ordre du Bas brun". Je suis probablement la seule professeure de Polytechnique à pouvoir se vanter d’avoir reçu ce prix "prestigieux" », s’esclaffe-t-elle.
C’est l’obtention d’une autre récompense illustre, bien réelle celle-ci, qui orienta la future carrière de la jeune diplômée en 1992. Elle parvint, en effet, à décrocher une des bourses internationales les plus réputées : la bourse Rhodes, qui ouvre les portes de l’Université d’Oxford, en Angleterre, à de brillants étudiants étrangers triés sur le volet. « Plusieurs personnalités canadiennes, dont des ministres, ont obtenu une bourse Rhodes. Aux yeux de mes parents, cette bourse était au panthéon des récompenses universitaires. J’avais postulé sans trop y croire », se souvient Catherine Beaudry.
Motivée par son envie d’acquérir une vision systémique des impacts du génie dans la société, elle opta pour une maîtrise en science économique. « Je ne voulais surtout pas faire le classique parcours ingénieur-MBA. Je voulais sortir du lot sur le marché du travail. Mes études à Oxford m’ont passionnée. Après ma maîtrise consacrée au système des enchères de contrats de satellites, j’ai poursuivi avec un doctorat portant sur l’offre et la demande en matière de satellites de télécommunications. Je crois que les satellites, qui observent la Terre dans sa globalité, reflètent ma volonté d’avoir une vision d’ensemble des systèmes », rapporte la professeure, qui ajoute : « Durant ma maîtrise, j’avais aussi rencontré mon futur mari, une raison de plus pour rester en Angleterre! »
En 1997, le couple emménage à Chester. Mme Beaudry occupe durant trois ans un poste à la Manchester Business School. Mais après avoir passé dix années loin de chez elle, elle commence à trouver pesantes les brumes britanniques. « J’étais en manque de nos hivers québécois, si blancs et si lumineux. De plus, nous attendions notre deuxième enfant et le coût exorbitant des services de garde en Angleterre menaçait de grever notre budget. J’ai convaincu mon Britannique de mari que nous établir au Québec serait judicieux. »
En 2002, Catherine Beaudry est donc de retour à Montréal, où un poste de professeure au Département de mathématiques et de génie industriel l’attend à Polytechnique.
Des chiffres et des histoires
Aujourd’hui, à la tête de la Chaire Innovation et du Partenariat pour l’organisation de l’innovation et des nouvelles technologies (4POINT0), cette chercheuse réputée s’attache à démystifier le processus de l’innovation et à développer des approches pour améliorer les écosystèmes d’innovation canadiens.
Pour améliorer, il faut pouvoir mesurer. Or, mesurer la performance des écosystèmes d’innovation, où les acteurs – entreprises, État, universités, regroupements d’experts, etc. – sont nombreux, n’est pas une mince affaire. « Que mesure-t-on exactement? La bonne gouvernance de l’écosystème? L’effet des politiques publiques de soutien à l’innovation? La performance des entreprises qui se trouvent dans un secteur donné? Et surtout, avec quels indicateurs? », questionne l’experte, qui a fait de ce besoin de déterminer les bons outils d’analyse un de ses chevaux de bataille.
« Les chiffres seuls ne racontent pas l’histoire. Or, nous, les humains, avons besoin d’histoires pour comprendre les choses. Donc, sans contexte, sans exemples, les indicateurs quantitatifs n’ont pas de signification. C’est pourquoi je réfléchis à la façon dont on construit des indicateurs, ainsi qu’au moyen d’allier la précision analytique des mégadonnées avec la richesse des études qualitatives pour mieux refléter la situation. »
La Pre Beaudry reproche à certains indicateurs de performance, outre leur faiblesse à reconstituer la réalité, d’encourager la concurrence entre organisations plutôt que la collaboration, plus profitable à tous. « Par exemple, quand on fait du nombre d’employés un indicateur de performance, alors qu’on est dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre. J’appelle ce type d’indicateurs un jeu à somme nulle. Si l’un gagne, l’autre perd », explique-t-elle.
Intérêt pour des champs peu étudiés
La Pre Beaudry souhaite également se pencher sur les appuis gouvernementaux fournis aux entreprises qui souhaitent exporter leurs technologies, que ce soit en matière de réglementation, de développement de normes internationales ou d’aides à l’exportation. « Nos entreprises se font trop souvent damer le pion à l’international. Actuellement, le processus vers l’exportation tient souvent du chemin de croix, surtout pour les petites et moyennes entreprises manquant de ressources pour remplir tous les formulaires requis par les programmes. Les organismes de soutien à l’exportation doivent travailler de concert entre eux et avec les entreprises pour leur éviter les embûches. La bonne gestion de la propriété intellectuelle, ainsi que la présence plus active du Canada à la table de négociations des normes internationales font aussi partie de la solution. »
Autre volet d’intérêt pour elle : la demande pour l’innovation. « Cette approche est encore peu étudiée, pourtant elle a un effet de levier assez significatif. Je pense notamment aux approvisionnements publics permettant de tester des innovations, parfois encore sous forme de prototypes, et d’accélérer leur développement in situ dans les services gouvernementaux. Traditionnellement, dans le domaine du génie, on se situe dans l’offre d’innovation, avec une approche de "poussée technologique" (technology push), souligne-t-elle. On cherche à faire valoir notre technologie, alors qu’il n’existe pas de demande clairement exprimée et établie pour celle-ci, et à créer un nouveau marché pour elle. »
Le danger de la poussée technologique, c’est de croire qu’une nouvelle technologie va automatiquement trouver preneur dans le public, estime Mme Beaudry. « Souvent, nos ingénieurs, éblouis par les capacités de leurs technologies, manquent de notions sur l’acceptabilité sociale, le marché, etc. Il est intéressant, par exemple, de regarder le cas de L’Oréal, qui, du jour au lendemain, a fait disparaître de sa communication publique, site Web compris, toute mention sur les nanotechnologies, dont le groupe est pourtant un champion. La raison? Pour ne pas déplaire à ses clients devenus très méfiants envers les nanotechnologies. Aujourd’hui, on vante beaucoup les promesses de l’intelligence artificielle, mais je pense qu’il faudra être très attentif à leur acceptabilité sociale. »
Appel au décloisonnement
Selon la professeure, tenir compte des souhaits du public et de ses besoins demande une concertation entre tous les acteurs de l’innovation. « À cause de la surspécialisation des uns et des autres, les liens entre les secteurs et disciplines ont du mal à se tisser. Il devient alors difficile de développer une vision commune et globale des problèmes de société et des solutions à apporter par l’innovation. Les choix faits par les collectivités reflètent souvent ce manque de concertation et d’intégration. Il suffit de penser, par exemple, aux lignes de transports en commun qui délaissent de grands pans de population, en particulier ceux qui ont de faibles revenus. Pour y remédier, développons un langage commun, sans jargon, et faisons tomber les murs entre les disciplines. Décloisonner est un de mes verbes favoris! »
À cet égard, Catherine Beaudry place de grands espoirs dans la nouvelle organisation des pôles stratégiques de la recherche de Polytechnique, notamment dans le pôle Environnement, économie et société. « Ce pôle multidisciplinaire et intersectoriel fournira, je l’espère, un espace collaboratif, où, dans le respect des expertises des uns et des autres, nous allons pouvoir discuter des impacts socio-économiques et environnementaux des nouveaux modèles d’infrastructures de services ou des nouvelles technologies, de la meilleure façon de concevoir les politiques publiques, la réglementation et les mécanismes d’appui à l’innovation. Ainsi, les innovations portées par nos ingénieurs trouveront l’appui industriel et gouvernemental nécessaire au bon moment, tout au long de leur développement, de l’idée à la commercialisation. »
Cette volonté de réfléchir à l’utilisation des avancées technologiques émergentes et à leurs enjeux environnementaux et sociaux rejoint les aspirations des nouvelles générations, croit-elle. « J’observe que les étudiants ont pleinement conscience qu’ils vivent dans un monde aux ressources finies, et qu’il faut "s’affranchir du conte de fée de la croissance perpétuelle", comme l’a revendiqué Greta Thunberg, et adopter un mode de vie responsable, durable et inclusif. C’est aussi pourquoi les indicateurs de croissance économique ne suffisent pas à mesurer les résultats de l’innovation. Il nous faut mesurer la croissance du bien-être, la réduction de la pauvreté, de la pollution, des maladies, etc. La question, des plus complexes, nécessite une grande équipe pour y travailler. C’est mon projet de la bâtir, et nous aurons beaucoup de travail! Il est minuit moins une, même pas moins cinq, pour s’engager dans la transformation sociétale. »


 disponible (Automne 2021)
disponible (Automne 2021)

