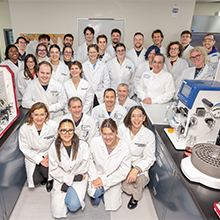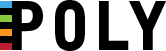
Le Magazine de Polytechnique Montréal
Biofabrication : Polytechnique Montréal mène le jeu dans l’Est du Canada

Pr Gregory De Crescenzo, du Département de génie chimique, instigateur de l'initiative RAMP-UP (Photo : Thierry du Bois)
RAMP-UP, une initiative majeure née à Polytechnique Montréal, s’attaque au grand défi de préparer le Québec et le Canada à répondre rapidement et stratégiquement à une prochaine éventuelle pandémie. Polytechnique Montréal conforte ainsi son rôle de plaque tournante dans l’Est du pays, à la fois pour former des personnes spécialisées en biofabrication et pour développer des procédés de production de vaccins et de médicaments biologiques.
En avançant dans le couloir du pavillon J.-Armand-Bombardier réservé aux bioprocédés, on prend conscience de chacune des étapes de fabrication d’un médicament biologique. Derrière la vitre d’un premier laboratoire, des cellules prolifèrent dans de grands bioréacteurs. Elles fabriquent des protéines thérapeutiques qu’on purifie juste à côté. Plus loin, des appareils spécialisés s’assurent de la qualité des échantillons purifiés. Et d’ici quelques semaines, des équipements additionnels permettront l’intensification des activités de ces laboratoires, en appui aux partenaires de ce grand projet de biofabrication.
RAMP-UP est une initiative de 20,5 millions de dollars provenant du Fonds de recherche biomédicale du Canada et du Fonds d’infrastructure et recherche en sciences biologiques. S’y ajoute une contribution de 11,7 millions de dollars de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), du gouvernement du Québec et des partenaires d’un autre projet biomédical, celle-là consacrée au développement de biomatériaux.
RAMP-UP rallie autour de Polytechnique Montréal ses partenaires historiques, notamment universitaires (Université de Montréal, Université Laval), collégiaux (CERASP, TransBioTech), gouvernemental (Conseil national de recherches du Canada) ou encore industriels de l’écosystème biopharmaceutique. Tous mutualisent leurs forces afin d’accélérer le développement de produits biopharmaceutiques, entre autres de vaccins, pour réagir promptement lorsque se déclarera la prochaine pandémie.
Identifier les composantes clés qui contribueront à la préparation d’un vaccin, les produire dans des cellules cultivées au laboratoire, puis les purifier : voilà seulement trois des étapes menant à la production d’un vaccin efficace. Encore faut-il mettre à l’échelle la production, formuler les doses pour des essais cliniques et s’assurer de la qualité du produit tout au long du processus. Grâce à ces investissements récents, l’équipe de RAMP-UP disposera de tous les outils pour s’acquitter de chacune de ces étapes.
Et, en dehors des périodes de grande turbulence, tous ces appareils de pointe n’accumuleront pas la poussière, loin de là. Ces plateformes technologiques serviront aussi à développer des médicaments biologiques à base de protéines et d’accélérer les délais entre découverte et commercialisation.
Former la relève avant tout

Dans le laboratoire du Pr De Crescenzo : lui-même, avec Vaiana Moreau, doctorante en génie chimique. En arrière plan, Julie Leclerc, stagiaire en génie chimique, et Fiona Milano, doctorante en génie biomédical (Photo : Thierry du Bois)
Voilà pour le côté plus technique du projet. Parce qu’à la racine de cette initiative se trouve aussi le besoin criant de former une relève spécialisée en biofabrication. C’est d’ailleurs cet aspect qui a été la bougie d’allumage du projet, explique Gregory De Crescenzo, instigateur de RAMP-UP et professeur titulaire au Département de génie chimique de Polytechnique Montréal.
« RAMP-UP est né d’un noyau très serré de professeurs, de professeures, de chercheurs et de chercheuses à la frontière des sciences fondamentales et du génie, partageant un riche historique de collaboration et une vision commune des enjeux de santé publique, confie-t-il. On s’est dit qu’en ne formant pas une relève compétente et dynamique, nous condamnerions le Québec et le Canada à dépendre des autres pays pour le développement de la prochaine génération de médicaments et de vaccins. C’est ce qui nous a motivés à nous unir pour mettre au point ce programme-là. »
Formé notamment au Conseil national de recherches du Canada (CNRC), ce groupe est bien au fait des besoins de l’écosystème des petites et moyennes entreprises québécoises qui œuvrent dans ce secteur. RAMP-UP est d’ailleurs conçu de façon à répondre à leurs besoins, confie le professeur De Crescenzo. « Nous allons former des gens compétents et polyvalents qui pourront évoluer dans un milieu en pleine renaissance à Montréal », dit-il.
L’enjeu de formation dépasse les limites des laboratoires de recherche publics du Québec, car toute une industrie dépend de la disponibilité de travailleurs hautement qualifiés. « Montréal tire incroyablement bien son épingle du jeu malgré les bouleversements que cette industrie a connus ces 20 dernières années, explique Gregory De Crescenzo. Les grandes pharmaceutiques sont parties, mais on voit émerger aujourd’hui plusieurs petites entreprises qui constituent la base d’un pôle fort en biopharmaceutique à Montréal, et on souhaite renforcer cet écosystème. »
Briser les silos
Fort de sa double formation, l’une en génie, l’autre en biochimie, le professeur De Crescenzo a pu tirer parti de plusieurs occasions enrichissantes tout au long de sa carrière.
Déjà en 2018, avec des collaborateurs, il a créé le programme de formation en ingénierie des procédés pour les nanomédicaments émergents, ou PrEEmiuM, un programme FONCER du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie Conseil du Canada (CRSNG). Celui-ci permet aux personnes étudiantes des cycles supérieurs d’un programme de pharmacie ou de génie des procédés de se familiariser avec le travail de leurs confrères et consœurs, en synergie avec les acteurs de l’industrie. « Nous manquons de personnes avec une double formation qui connaissent chacun le langage de l’autre, et c’est ce qu’on souhaitait corriger avec PrEEmiuM. »
L’objectif avoué de la démarche : briser les silos pour que toutes et tous comprennent les contraintes de la création d’un médicament, de sa découverte jusqu’à sa commercialisation, et ainsi multiplier les réussites. « C’est une chose de réfléchir au design d’une protéine en laboratoire, c’en est une autre de la produire à grande échelle. En effet, le changement d’échelle engendre des difficultés qui doivent être prises en compte dès le départ, sans quoi tout ce travail devient inutile, explique le Pr De Crescenzo. Avec PrEEmiuM, on amène des personnes en génie et en pharmacie à se poser les bonnes questions dès le départ. »
Comme pour les autres programmes FONCER, les stagiaires bénéficient d’un encadrement de trois ans au doctorat et de deux à la maîtrise. Depuis sa création, PrEEmiuM a formé 70 étudiantes et étudiants provenant de partout au pays, souligne avec fierté son instigateur. « Le volet formation de RAMP-UP nous donne les moyens concrets de pérenniser PrEEmiuM en le bonifiant grâce à OPSIDIAN, un autre programme FONCER dirigé par la Pre Isabelle Villemure. »
Une passion née dans un microscope
Gregory De Crescenzo avait 10 ans lorsqu’il a décidé de faire carrière dans le grand monde du très petit. Un coup d’œil dans un microscope à l’école, et son destin était scellé. « Mon professeur avait fait macérer des plantes et un peu de terre dans de l’eau pour faire pousser des bactéries pendant quelques jours, raconte-t-il. Lorsque j’ai vu ce qu’il y avait là-dedans, j’ai tout de suite compris ce que je voulais faire de ma vie. »
Arrivé au moment de choisir une université quelques années plus tard, le Sétois opte pour une formation en génie à Toulouse, qui lui offrait un meilleur encadrement que des études facultaires.
Et Montréal dans tout ça?
C’est grâce à un stage d’un an au baccalauréat qu’il a d’abord découvert le Québec. « Une occasion de partir à l’étranger pour apprendre l’anglais (rires) » s’était présentée à lui. « Ça m’a conduit au CNRC à Montréal, et c’est durant ce stage que j’ai rencontré celle qui est devenue ma superviseure de doctorat, Maureen O’Connor-McCourt, raconte-t-il. Grâce à mon parcours, j’ai toujours pu surfer sur les vagues qui se présentaient à moi, en me fiant à mon intuition. »
La déferlante suivante aura lieu en 2004 à Polytechnique Montréal, alors que démarrait le programme de génie biomédical. Une occasion en or de passer à l’étape supérieure en mettant à profit ses expériences universitaires et au sein d’un laboratoire fédéral.
Et c’est ainsi que de fil en aiguille, une vocation née sous le microscope d’une école primaire a mené à l’élaboration de deux programmes de formation et de recherche qui soutiendront l’industrie biopharmaceutique au Québec des années durant.


 disponible (Été 2024)
disponible (Été 2024)