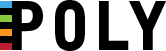
Le Magazine de Polytechnique Montréal
Plaidoyer pour une science à impact
Portraits de professeurs
Ayant grandi dans un petit village de la Suisse italophone, Manuele Margni a toujours voué à la nature un amour profond et souhaitait lui consacrer son futur métier. « Je voulais un travail en plein air essentiellement, se rappelle-t-il. Aujourd’hui, je fais de la modélisation et je suis enfermé la plupart du temps dans un bureau… Mais j’en suis quand même très content! »

Manuele Margni, professeur au Département de mathématiques et gémie industriel
Aventure entrepreneuriale soutenue par la science
En 1991, poussé par son envie de protéger la nature, il est entré à l’École Polytechnique Fédérale de Zurich (EPFZ) pour étudier en ingénierie environnementale. Diplômé en 1996, l’année de l’instauration de nouvelles normes ISO 14001 en gestion environnementale, il intègre l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) pour une maîtrise en génie et management de l’environnement, consacrée à la gestion des politiques environnementales en milieu industriel. « Un de mes professeurs, Olivier Jolliet, dont l’enseignement sur les notions de l’analyse du cycle de vie (ACV) m’avait passionné, m’a proposé un doctorat. L’idée m’intéressait, mais je souhaitais d’abord me frotter au monde de l’entreprise. » À peine quelques mois après sa maîtrise, le jeune diplômé se lance dans la création d’une entreprise de conseil en gestion et ingénierie environnementales, afin d’aider les entreprises à se certifier ISO 14001 et à gérer leurs déchets.
Au tournant de l’année 2000, le Pr Jolliet le sollicite à nouveau pour un doctorat consacré à l’ACV. Cette fois, Manuele Margni accepte, en s’assurant de pouvoir poursuivre une partie de ses activités dans son entreprise. Durant son doctorat, il séjourne à l’Université de Californie à Berkeley, ce qui lui permet d’améliorer grandement sa maîtrise de l’anglais au point de pouvoir rédiger sa thèse dans cette langue.
« En 2003, doctorat en poche, je suis retourné me consacrer à mon entreprise, tout en continuant à collaborer avec le Pr Jolliet. Comme celui-ci n’avait pas un poste permanent à l’EPFL, il a fini par partir à l’Université du Michigan, sans personne pour reprendre le flambeau de l’ACV à l’EPFL, où ce domaine était considéré comme mineur. Je souhaitais que cette expertise demeure en Suisse et qu’elle soit valorisée. J’ai proposé à Olivier de faire un essaimage, en créant une entreprise de conseils en ACV. Nous faisions un travail de pionniers. Si le principe lui-même est assez facile à expliquer aux entreprises, le défi réside dans la quantification : comment générer efficacement les données, les valider et les combiner pour pouvoir dresser un inventaire du cycle de vie d’un bien ou d’un service ? Comment traduire ensuite cet inventaire en termes d’impacts sur les changements climatiques et la santé humaine ? Les connaissances scientifiques nous permettaient de sortir du qualitatif pour enfin mettre des chiffres devant des perceptions. Ainsi est née Quantis. Elle emploie aujourd’hui 250 personnes », indique le Pr Margni.
Entre le Québec et la Suisse
En 2005, Manuele Margni reçoit un courriel laconique qui va être à l’origine d’un développement de carrière inattendu : le Pr Réjean Samson, du Département de génie chimique de Polytechnique Montréal, dont il avait fait la connaissance à l’occasion de congrès scientifiques, lui demande si un poste de professeur dans son département l’intéresserait. La réponse est affirmative et quelques mois plus tard, Manuele Margni rejoint le Département de génie chimique et intègre l’équipe du Centre international de référence sur l'analyse du cycle de vie et la transition durable (CIRAIG) fondé par le Pr Samson. Il développe des mesures de durabilité intégrant des perspectives de cycle de vie et participe à la création de la Chaire internationale sur le cycle de vie (CICV), consacrée au développement d’outils de mesure de l’empreinte environnementale de la production de biens ou de services, dont le troisième mandat vient de s’achever.
Au bout de quelques années, le CIRAIG se rapproche fortement de l’Europe. « Au départ, la moitié des partenaires industriels de la CICV étaient canadiens. Aujourd’hui, 80 % sont européens, rapporte le Pr Margni. Durant l’année 2017-2018, j’ai fait une année sabbatique à l’EPFL, auprès du Pr François Maréchal dans un laboratoire de design de procédés, où se réalisent en particulier des projets d’optimisation de systèmes énergétiques. François Maréchal développe des modèles qui permettent de déterminer des stratégies énergétiques au moindre coût et avec le plus gros avantage environnemental. Il apporte une vision systémique aux problèmes énergétiques. En contrepartie, intégrer la vision cycle de vie évite l’adoption des fausses bonnes solutions qui ne font que déplacer les problèmes, telles que la ruée sur les biocarburants qui a mené à la déforestation de vastes territoires. Nos deux expertises s’alliant naturellement, François et moi avons monté une antenne européenne du CIRAIG. »
Un contexte favorable
Actuellement, la CICV évolue vers un consortium international de recherche sur le cycle de vie et la transition durable, réunissant Polytechnique, l’UQÀM, l’EPFL et la Haute École Supérieure de la Suisse occidentale, une école d’ingénierie appliquée. Une douzaine de partenaires industriels investissent dans le consortium, dont les activités ont le vent en poupe.
« La mondialisation s’est faite sans réflexion suffisante sur les chaînes d’approvisionnement, constate le Pr Margni. La pandémie a mis en évidence la méconnaissance de ces longues chaînes par le milieu économique, ainsi que leur vulnérabilité. Or, comprendre les chaînes de valeur fait partie de l’ACV. La pertinence de nos travaux s’est tout à fait révélée aux entreprises. À cela, s’ajoute la crise énergétique actuelle, qui exige l’adoption de nouvelles approches. Désormais les gros cabinets de conseil réalisent qu’on ne peut plus développer une stratégie d’entreprise sans intégrer la durabilité, et pas seulement par des considérations qualitatives, mais en employant des outils de mesure quantitatifs et scientifiquement solides. Nos finissants sont fortement recherchés et nous avons peine à satisfaire à la demande. Quand je pense qu’à nos débuts, nous avions l’impression de prêcher dans le désert…»
Polliniser la réflexion des ingénieurs
Le Pr Margni se réjouit que le cours d’ACV soit devenu un cours transversal accessible dans tous les programmes de Polytechnique grâce à la collaboration du Département de génie chimique et le Département de mathématiques et génie industriel, qu’il a rejoint en 2011. Il souhaite qu’il en soit de même pour l’écodesign, une approche holistique qui permet d’intégrer des critères de développement durable dès la conception de procédés, technologies ou produits.
« Le monde a besoin d’experts en développement durable, mais avant tout d’ingénieurs possédant une vision systémique des problèmes et sachant intégrer l’ACV et les questions de durabilité à leur réflexion dès qu’ils commencent à considérer une solution, estime-t-il. La demande est forte chez nos étudiants d’ici et de Suisse pour acquérir ces capacités. Polytechnique Montréal et l’EPFL ont jugé pertinent de lancer conjointement il y a deux ans un cours en ligne ouvert à tous sur l’ACV. Il a figuré dans un palmarès dressé par le journal français Les Échos en 2021. »
Vision holistique du changement
Autre nécessité, selon lui : en recherche appliquée, donner la priorité absolue aux travaux contribuant à favoriser la mitigation et l’adaptation aux changements climatiques. « Les problèmes actuels ne vont cesser de s’amplifier et seront extrêmement coûteux d’ici quelques années. Et pourtant, on continue d’extraire des ressources fossiles. Il est urgent de trouver des solutions à impact en termes d’environnemental et de durabilité. Tous les chercheurs en génie devraient s’interroger sur la pertinence actuelle de leurs recherches et se demander comment leur savoir peut aider à accélérer la transition. »
Il souligne qu’il faut aussi changer les modèles d’affaires des entreprises, afin qu’ils ne se basent plus sur l’extraction et de la vente de la ressource, mais sur une chaîne de valeur optimisée. « Il n’y a plus de raison que les décideurs continuent à hypothéquer l’avenir des nouvelles générations pour garder le statu quo dans les affaires. Les entreprises doivent s’entendre avec les autres acteurs de la chaîne de valeur pour extraire moins de ressources, libérer moins de GES, atteindre une meilleure efficience matérielle et énergétique de la société et minimiser les externalités environnementales. Cette vision systémique de la chaîne de valeur donnera plein d’occasions de se développer différemment, croit-il. Les entreprises qui arrivent à innover dans leurs modèles d’affaires seront celles qui s’imposeront. »


 disponible (Automne 2022)
disponible (Automne 2022)

