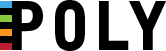
Le Magazine de Polytechnique Montréal
La recherche à Polytechnique : survol d’un demi-siècle de métamorphoses
Évoluer
Il n’aura guère fallu plus d’une cinquantaine d’années à Polytechnique pour devenir un pôle multidisciplinaire de recherche et d’innovation d’envergure mondiale en génie.
À l’origine de ce succès spectaculaire : l’influence de personnes visionnaires conjuguée à la capacité de l’établissement à tirer parti des révolutions technologiques et à demeurer en phase avec les transformations de la société.
De l’approche fondamentale à l’approche appliquée

Laboratoire haute tension, 1965 (Bureau des archives, Polytechnique Montréal)
L’essor de la recherche à Polytechnique est étroitement lié au développement des grandes infrastructures, notamment celles d’Hydro-Québec, qui sont alors en train de transformer le Québec.
Jusqu’aux années 70, la recherche effectuée à Polytechnique consiste essentiellement en travaux sur des matériaux ainsi qu’en essais hydrauliques et mécaniques utiles à la construction des grands ouvrages civils, tels que les barrages. D’ailleurs, en s’aventurant dans les sous-sols de notre pavillon principal, on peut encore découvrir les vestiges des grands bassins qui servaient à tester des modèles réduits de barrages il y a plus de 50 ans.
L’intégration d’un volet nucléaire à la stratégie énergétique du Québec donne lieu à la création de l’Institut de génie nucléaire en 1970 (fondé par le Pr Wladimir Paskievici), en vue de développer des expertises et de former des spécialistes pour soutenir le programme nucléaire d’Hydro-Québec. Bien que ce programme soit aujourd’hui abandonné par Hydro-Québec, l’empreinte de Polytechnique dans le domaine nucléaire perdure : tous les réacteurs de type Candu au monde exploitent des modèles de logiciels développés à Polytechnique (à l’origine par l’équipe du Pr Daniel Rozon, et maintenant par celles des Prs Alain Hébert et Guy Marleau).
À la même époque, sous l’influence de son premier directeur de la recherche, le Pr Roger A. Blais, Polytechnique fait entrer pleinement la recherche et l’innovation dans le cœur de sa mission. Elle développe intensivement ses liens avec l’industrie dans plusieurs secteurs, établit une communication directe avec les organismes subventionnaires et engage massivement des professeurs-chercheurs. Elle se dote d’un programme de recherche ainsi que d’un programme de bourses pour les cycles supérieurs. Sous l’impulsion du Pr Blais, plusieurs initiatives voient le jour à Polytechnique, telles que la mise en place d’un conseil de la recherche, la création de plusieurs centres de recherche ou celle du Centre de développement technologique, notamment.
Le visage de la recherche tel que nous le connaissons aujourd’hui ne serait pas complet sans le volet de la valorisation de nos technologies. Celle-ci se formalise vers la fin des années 90, avec la mise sur pied de la société de valorisation Polyvalor (devenue par la suite Univalor) par le directeur du Bureau de la recherche et Centre de développement technologique (BRCDT), Denis N. Beaudry. Univalor, dont les activités englobent l’octroi de licences, les demandes de brevets ainsi que la création d’entreprises dérivées, perdure jusqu’en 2021, où elle sera remplacée par la société de valorisation québécoise Axelys.
De nouvelles perspectives grâce à l’augmentation de la capacité de calcul
Jusqu’au tournant des années 80, nos chercheurs se basaient sur des données fournies par les mesures expérimentales pour effectuer leurs projets de conception et de recherche. La nouvelle décennie ouvre la voie à la modélisation informatique avec un projet majeur : une équipe de recherche encadrée par les Prs René Tinawi, Riccardo Camarero et Claude Marche obtient un contrat de la Ville de Montréal pour réaliser un modèle intégré d’aménagements hydrauliques. Pour ce faire, l’équipe développe une approche de simulation basée sur les éléments finis pour étudier l’écoulement de l’eau autour de l’île de Montréal en tenant compte de la bathymétrie du fleuve. Le projet, nommé CASTOR, reçoit à l’époque la plus importante subvention du CRSNG accordée au Canada dans le cadre d’une R & D coopérative.
Notre expertise en modélisation est favorisée par l’essor de la micro-informatique, ainsi que par l’augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs. Toutefois, comme l’utilisation de données expérimentales demeure indispensable, nous la combinons maintenant à la modélisation. Aujourd’hui, nous sommes capables d’utiliser en temps réel les données obtenues avec nos appareils de mesure pour les intégrer à nos modèles en vue d’effectuer des simulations extrêmement réalistes (jumeaux numériques).
Matériaux : naviguer entre les échelles

Des équipements au laboratoire de microfabrication du Groupe de recherche en physique et technologie des couches minces
L’observation du changement d’échelle entre divers types de projets est une autre façon de considérer la transformation de la recherche. Depuis les années 70 en effet, nos laboratoires s’équipent d’instruments de plus en plus sophistiqués. Nos équipes de recherche sont désormais en mesure de traverser un continuum entre l’échelle atomique et l’échelle macro. Ceci leur permet de mieux comprendre le comportement des matériaux grâce à une meilleure connaissance de leurs propriétés atomiques. Le contraste est particulièrement frappant entre les projets menés au Laboratoire de microfabrication du Groupe de recherche en physique et technologie des couches minces, ou au Laboratoire des semiconducteurs nanoscopiques, et ceux menés au Laboratoire de structures sur des éléments d’ouvrages civils en pleine grandeur.

Installations du laboratoire de structures
Les algorithmes révolutionnent la prise de décision
L’augmentation de la puissance de calcul soutient également nos avancées en optimisation et en recherche opérationnelle, qui donnent lieu depuis les années 90 au développement d’outils d’aide à la décision transformant les stratégies des entreprises. Le Pr François Soumis est représentatif du leadership de Polytechnique dans ce domaine. Cet expert en optimisation des grands réseaux de transport a créé une entreprise qui offre des systèmes de gestion des horaires à des compagnies aériennes du monde entier. Un autre de nos éminents spécialistes en optimisation, le Pr Gilles Savard, est quant à lui à l’origine d’une approche méthodologique novatrice en gestion des revenus, dont dérive l’entreprise ExPretio, fournisseur d’outils de gestion de revenus pour les compagnies aériennes et ferroviaires.
On assiste dans les années 2010 à une convergence de la recherche opérationnelle, de la science des données et de l’intelligence artificielle (IA) vers l’exploitation des données massives en vue de créer de la valeur. La création de l’Institut de valorisation des données (IVADO) en collaboration avec l’UdeM et HEC en 2016 avec le soutien du programme fédéral Apogée vise à catalyser les progrès dans ce domaine afin d’offrir aux entreprises des solutions permettant d’améliorer leur compétitivité.
Par ailleurs, l’IA, qui a fait ses preuves dans l’analyse et l’interprétation des données, transforme à son tour notre façon de réaliser nos projets de recherche, car elle peut aujourd’hui résoudre des problèmes appliqués et s’intégrer à la conception des innovations. Très consciente des risques et des enjeux éthiques liés à l’IA, Polytechnique s’engage à la développer de façon responsable. Elle est, à cet égard, membre de l’Observatoire OBVIA sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique.
Une dynamique interdisciplinaire innovante

Les projets en génie orthopédique du Pr Carl-Éric Aubin, fondateur de l'Institut TransMedTech (Photo : Caroline Perron)
À Polytechnique, le cliché du chercheur dans sa tour d’ivoire a fait long feu. Une interdisciplinarité croissante depuis cinq décennies offre de nouveaux angles à nos chercheurs pour aborder des problèmes de plus en plus complexes. Ceux-ci, en conjuguant leurs connaissances avec celles d’experts d’autres disciplines, se sont montrés de plus en plus innovants dans leurs solutions.
Si la tendance à l’interdisciplinarité, voire à la transdisciplinarité, s’accélère à partir des années 2000 dans tous les domaines, c’est sans doute dans celui du génie biomédical qu’elle est la plus éclatante. En 2017, la création de l’Institut TransMedTech à l’initiative du Pr Carl-Éric Aubin l’illustre clairement. S’appuyant sur une approche de laboratoire vivant, cette structure rassemble des chercheurs, des cliniciens de diverses disciplines, des industriels, des patients et des acteurs du système public. Ces parties prenantes peuvent ainsi créer et développer ensemble des solutions technologiques destinées au diagnostic, au pronostic et à l’intervention, en vue d’améliorer le traitement de maladies complexes comme le cancer et la réadaptation des patients. Selon le principe fondateur du laboratoire vivant, l’innovation est en effet plus probable quand le receveur est impliqué dans sa conception. Nous souhaitons aujourd’hui appliquer cette approche à d’autres secteurs, tels que la mobilité. À une échelle plus large, nos pôles d’excellence en recherche reflètent également notre vision résolument interdisciplinaire de la recherche.
La rétrospective des transformations successives de l’aspect de la recherche réalisée à Polytechnique couvrirait des pages et des pages. Je ne vous en ai donc proposé ici qu’un survol. Toutes ces transformations, tous ces changements de paradigmes traduisent cependant la volonté restée intacte de notre université : avoir, par ses contributions scientifiques et technologiques, un impact significatif et durable sur la société.


 disponible (Hiver 2023)
disponible (Hiver 2023)

