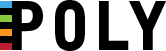
Le Magazine de Polytechnique Montréal
Delphine Périé-Curnier, chercheuse aux pieds ailés
Portraits de professeurs
Se dépasser grâce au sport
Comment fait-on pour mener de front des travaux de chercheuse en génie mécanique, de nouvelles responsabilités de directrice d’une instance universitaire, une vie de famille et un entraînement de triathlète de haut niveau ? « C’est justement ma pratique sportive régulière qui m’aide à être plus efficace dans mon travail. Elle me permet d'évacuer le stress et de mieux me concentrer plus longtemps. Elle m’apporte un équilibre et me motive à bien m’organiser dans mes tâches pour pouvoir consacrer du temps à mon entraînement », répond la Pre Delphine Périé-Curnier, qui dirige des projets en génie biomédical à l’hôpital Sainte- Justine et qui a été récemment promue à la direction des Études supérieures de Polytechnique.
La chercheuse-athlète revient des championnats du monde de triathlon individuel longue distance, qui se sont déroulés en Afrique du Sud. « Une très belle expérience. Les paysages là-bas sont si époustouflants que, durant l’épreuve de cyclisme, j’étais presque tentée de m’arrêter pour les contempler ! »
Originaire de la région de Toulouse, en France, dont elle a gardé une pointe d’accent chantant, Delphine Périé-Curnier est devenue une sportive accomplie dès le collège. « J’ai commencé avec la natation, que j’ai pratiquée de nombreuses années, jusqu’à obtenir un Brevet d’État d’éducateur sportif dans cette discipline.» C’est d’ailleurs un jour où elle s’entraînait en piscine qu’elle a fait la connaissance de celui qui allait devenir son mari : Daniel Curnier, maintenant professeur au Département de kinésiologie de l’Université de Montréal, confie-t-elle. Lui-même triathlète, il lui a communiqué sa passion pour cette discipline exigeante. Aujourd’hui, la Pre Périé-Curnier participe à au moins trois compétitions par an, dont un Ironman, ainsi qu’à plusieurs courses à pied.
Observer la mécanique humaine avec des yeux d’ingénieure
Lorsqu’elle était enfant, elle s’imaginait faire de la recherche médicale. Quand elle est entrée à l’université, elle se destinait plutôt à devenir professeure de mathématiques. « Arrivée en licence, l’aspect très théorique des mathématiques m’en a dissuadée, rapporte-t-elle. Cela devenait trop abstrait pour moi, c’est pourquoi je me suis tournée vers le génie mécanique. En découvrant la biomécanique auprès de chirurgiens orthopédiques, j’ai su que j’avais trouvé ma vocation. Finalement, celle-ci n’est pas si éloignée de mes rêves d’enfant. »
La recherche qu’elle mène à l’hôpital Sainte-Justine est consacrée au développement d’outils de détection des modifications du tissu cardiaque à un stade précoce chez les patients ayant reçu un traitement par chimiothérapie. Ses travaux visent en particulier la prévention des effets tardifs des traitements administrés aux enfants atteints de leucémie. « Les traitements du cancer par chimiothérapie peuvent dégrader les tissus cardiaques, explique-t-elle. Leurs effets cardiotoxiques ne sont actuellement pas détectés de façon précoce par l’échographie classique et, peu à peu, le myocarde risque de perdre de son élasticité. Or, en étudiant les champs de déformation des tissus cardiaques, on peut déceler les premiers changements dans la réponse mécanique de ces tissus aux traitements par chimiothérapie, ce qui permettrait de dépister plus tôt les pathologies et donc de les soigner plus tôt. »
Ultimement, les outils de détection semiautomatique des contraintes mécaniques du myocarde qu’elle développe avec son équipe seraient installés sur les consoles d’échographie et d’imagerie par résonance magnétique (IRM), afin que les cliniciens puissent les utiliser pour poser un diagnostic. Ces outils pourront également servir à tester de nouvelles méthodes de prévention. « Mon souhait serait qu’un jour des appareils puissent scanner le corps en entier afin d’observer en une seule séquence les détails des propriétés mécaniques des tissus et de déceler d’éventuels problèmes. »
En parallèle, Delphine Périé-Curnier développe en collaboration avec son mari un projet lié à l’intérêt qu’elle porte aux performances sportives. Ce projet vise à optimiser la position d’un cycliste sur son vélo. « Beaucoup de travaux de R&D sont menés pour améliorer les pièces et le cadre des vélos afin d’augmenter l’aérodynamisme, mais très peu s’intéressent à la position de celui qui pédale. » Son projet consiste à étudier les performances biomécaniques, physiologiques et aérodynamiques d’un cycliste en fonction de sa position et à concevoir des outils permettant d’optimiser ces performances. « Daniel étudie l’aspect physiologique, soit les modifications du rendement cardiaque, tandis que je conçois les modèles numériques », précise la chercheuse qui utilise, entre autres, ses propres données d’entraînement.
Encourager les femmes à moins douter de leurs compétences
Pour la Pre Périé-Curnier, devenir directrice des études supérieures signifie participer activement au développement des programmes de formation et à l’encadrement, ainsi qu’à l’amélioration des processus. « L’interdisciplinarité s’invite de plus en plus dans les programmes et c’est intéressant de travailler concrètement à leur transformation. Je découvre aussi tout l’aspect réglementaire lié aux décisions administratives, un domaine qui demande une grande rigueur. »
Sa participation à divers comités l’avait préparée à ce genre de responsabilités. « Il a toutefois fallu qu’on me convainque de postuler, car je n’aurais pas pensé à
le faire spontanément. Comme beaucoup de femmes, j’ai souvent besoin d’être assurée à 100 % de mes compétences pour les faire valoir. J’observe cette tendance aussi chez nombre de mes étudiantes. À cet égard, j’espère que ma nomination les encouragera à avoir davantage confiance en elles. Elle leur montre que les portes s’ouvrent aux femmes qui veulent obtenir plus de responsabilités dans les organisations. » L’annonce de sa nomination lui a d’ailleurs valu de nombreuses félicitations de la part d’étudiantes qui lui ont fait savoir qu’elle représente un modèle inspirant.
«Inspirer, transmettre et accompagner, c’est pour moi l’essence du métier d’enseigner», conclut la professeure.


 disponible (Automne 2018)
disponible (Automne 2018)
